Mieux comprendre la colère
Ah la colère ! Une émotion qui nous pose tellement de problèmes … Dans l’épisode précédent – l’épisode 9 – vous avez pu écouter ma conversation sur la colère avec Cécile Guinnebault, coach en entreprise. Nous avons exploré ensemble les parallèles entre la colère dans le monde du travail et dans la parentalité. Je trouve que cette discussion a soulevé des points essentiels que j’ai eu envie d’approfondir dans une série d’épisodes dédiées à la colère, cette émotion qui est si mal comprise et pourtant si utile. Voici donc le 2e épisode de cette série sur la colère. Il porte sur les mécanismes de la colère, son utilité et ses pièges.
Pour écouter ce nouvel épisode du podcast en audio, c’est par ici :

Ep. 10 mieux comprendre la colère – Du côté des parents !
Beaucoup de parents me consultent pour des motifs qui tournent autour de la colère, la leur ou celle de leurs enfants. Voilà le programme que je vous propose autour de la colère :
- Dans cet épisode-ci, je vous propose une introduction générale sur la colère pour approfondir son rôle, son fonctionnement, et mieux comprendre ses mécanismes
- Dans l’épisode suivant, je parlerai de la colère des enfants, et notamment des jeunes enfants. Une colère qui est souvent explosive, débordante à laquelle on ne sait pas toujours comment réagir
- Et enfin, le dernier épisode de la série, le quatrième portera sur la colère des parents. Je vous y proposerai des pistes pour mieux la réguler
Commençons par poser les bases pour comprendre ce que c’est que la colère, pourquoi elle est si mal perçue, pourquoi elle est pourtant essentielle. J’espère vous montrer pourquoi j’aime autant la colère ! Et j’aborderai aussi ce qui peut mener au débordement de la colère et à ses explosions.
Qu’est-ce que la colère ? Et pourquoi pose-t-elle autant de problèmes ?
La colère est souvent mal vue, et même de plus en plus mal vue.
Nous l’avions souligné avec Cécile dans l’épisode précédent. Cela vient en grande partie d’une confusion entre colère et violence.
Dans notre société, la violence dans les relations est de moins en moins tolérée. Et plus particulièrement dans les relations avec les enfants. C’est une évolution tout à fait positive : pn se préoccupe de ce que vivent les enfants, de ce qu’ils ressentent ; on ne veut plus de rapport de force, de rapport d’autoritarisme dans les relations parents-enfants. Et ça c’est vraiment chouette !
Mais cette moindre tolérance à la violence s’accompagne d’une difficulté à distinguer entre l’émotion de colère et ces débordements violents. Et c’est ça qui pose problème.
Cette confusion entre la colère et la violence nous met dans une situation paradoxale quand on a de la colère à exprimer.
Elle amène pas mal de questions sur la légitimité de la colère : est-ce légitime d’imposer quelque chose à un autre personne ?
Cela va nous faire hésiter à exprimer nos colères. On va aussi chercher à policer la forme pour exprimer notre colère d’une manière acceptable et positive. Autrement dit : « énervez-vous mais calmement !« .
Implicitement, il est aussi attendu de prendre sur nous si jamais on ne peut pas être entendu, surtout avec nos enfants.
Tout le paradoxe de la colère est là : ma colère me pousse à exprimer un besoin, une limite. Mais si l’autre ne veut pas changer son comportement, je fais quoi ?
Disqualifier la formulation peut augmenter la colère
Rejeter la forme de la colère quand elle est jugée trop agressive revient aussi à disqualifier le fond du message. Cela autorise à ne pas tenir compte de la demande … ce qui a pour effet d’augmenter la colère de la personne, déjà en colère au départ, et donc de la conduire à un débordement émotionnel.
Ce phénomène est particulièrement problématique quand on est dans un rapport social de domination : quand une catégorie dominée exprime de la colère, elle voit souvent ses revendications rejetées pour des questions de forme par la catégorie dominante.
Pensez aux revendications sociales, aux revendications féministes, aux revendications écologistes, et à ce qui en est renvoyé à ces militants sur la forme : pas assez ceci, trop cela, etc.
Ce rejet de la forme renforce la frustration de la catégorie dominée qui ne voit pas comment s’exprimer plus justement et plutôt le sentiment que c’est un moyen de la faire taire. Ce qui risque d’amener une expression de plus en plus violente, conduisant à d’autant plus de rejet. Et on arrive dans un rapport conflictuel qui ne va pas dans le sens de la non-violence qu’on souhaitait au départ.
Ce schéma existe aussi dans les relations de couple : si on s’énerve trop, ça discrédite nos demandes. Mais si on s’exprime calmement, nos demandes apparemment ne sont pas entendues. Mais si j’insiste (en haussant un peu le ton) les demandes sont disqualifiées parce qu’elles sont trop agressives.
Je ne m’étends pas sur le sujet, mais j’aborderai ce sujet dans une autre série d’épisodes. A noter : on rencontre le même phénomène avec les colères des ados. Une série d’épisodes est aussi en préparation à ce sujet, mais vous pouvez déjà lire cet ancien article « les ados, difficiles ou juste agacés par leurs parents ?«
Ce rapport de domination existe en effet aussi dans les relations parent / enfant.
Si un enfant exprime sa colère d’une manière qui est jugée incorrecte et qu’on s’arrête à la manière dont il exprime sa frustration ou sa colère, il ne se sent pas entendu sur le fond. Cela va amplifier sa frustration et conduire à un débordement émotionnel. Débordement qui justifie la disqualificatio de l’expression de sa frustration et ainsi de suite.
Ceci n’est pas une vue de l’esprit : les enfants et ados me le décrivent régulièrement dans mon cabinet. Un exemple ? Lucie a 11 ans, elle rêve d’un téléphone portable mais ses parents ne veulent pas. Elle comprend les risques, et les limites, elle veut juste pouvoir envoyer des messages avec des emoji à ses camarades de classe … Elle tente d’aborder le sujet avec ses parents pour savoir quand ce sera envisageable que la règle soit assouplie. Mais dès qu’elle aborde le sujet, ses parents lui renvoient « arrête avec ton téléphone. Si tu réclames, c’est bien la preuve que tu es accro alors que tu n’en as même pas encore un ! ». Et quand elle insiste sans succès, et finit par s’énerver parce qu’elle aimerait au moins que ce sujet soit abordé et que ce n’est pas possible, ses parents lui renvoient que vu comme elle est immature, ça ne risque pas d’arriver de si tôt. Pas étonnant qu’elle soit en permanence frustrée et énervée non ?
Je reviendrai plus en détail sur ce sujet dans l’épisode sur la colère des enfants. Mais ça nous donne une information précieuse :
Quand notre colère n’est pas entendue ou qu’on disqualifie un aspect pour ne pas entendre le fond du message, elle a plutôt tendance à augmenter !
En résumé, pour cette première partie :
Les injonctions liées à la diminution souhaitée de la violence conduisent à un contrôle étroit de la colère dans notre quotidien. Et malheureusement, émotions et contrôle font rarement bon ménage, particulièrement pour la colère (mais c’est assez vrai pour toutes les émotions).
La colère, une émotion forte en énergie
Il me semble important de préciser ce qu’est la colère, comment elle marche, pour que vous compreniez un peu mieux ses mécanismes.
Vous avez peut-être été surpris-e que je dise que j’aime beaucoup la colère. Et je vais vous expliquer pourquoi.
La colère est une émotion porteuse d’énormément d’énergie. C’est une émotion qui nous met très fort en mouvement. Ca peut faire peur (que faire de cette puissance ?), ça peut la rendre désagréable à ressentir.
Ca peut la rendre désagréable pour l’entourage : cette énergie met la pression aux autres, ils ne savent pas comment résister à autant de puissance. C’est aussi ce qui fait qu’on peut confondre colère et violence.
Mais retenez surtout que c’est une émotion qui met en mouvement. C’est une émotion enthousiasmante finalement !
C’est en effet la seule qui nous pousse à faire quelque chose pour que les choses changent ! C’est plutôt chouette non ?
Le message de la colère
Toutes les émotions sont porteuses d’un message. Elles sont des signaux destinés à nous alerter sur ce qui nécessite une attention, voire une intervention de notre part.
La colère, c’est l’émotion qui dit « ceci ne me convient pas ».
C’est une émotion qui parle de nos limites, de nos besoins, de nos valeurs. C’est l’émotion qui se manifeste quand on se fait marcher sur les pieds et qu’on trouve ça inacceptable et qu’on veut que ça s’arrête.
La colère est donc avant tout l’émotion du respect de soi !
Aucun changement social, aucune révolution ne s’est jamais faite sans une saine colère à la base.
Si tout le monde est content ou résigné, il n’y a aucune raison que les choses changent. C’est seulement si quelqu’un se met en colère et l’exprime que les choses peuvent changer.
« Respectez-moi ! », c’est ça qu’elle dit la colère.
Que se passe-t-il quand on n’écoute pas assez sa colère ?
Dans le contexte de rejet de la violence actuel, on a tendance à ne pas agir assez quand on est en colère. Quelles conséquences cela a-t-il ?
Les émotions ce sont des signaux d’alarme Si vous cherchez à éteindre ce signal sans tenir compte du problème sur lequel il vous alerte, il ne va pas s’éteindre : il va sonner plus fort.
Ne pas écouter sa colère, c’est comme essayer d’éteindre un signal d’alarme alors qu’il y a vraiment un incendie en train de démarrer. Ce signal d’alarme perfectionné qu’est l’émotion va continuer de sonner à juste titre. Son message est : « Non, non, il y a un début d’incendie ! Je ne vais pas m’éteindre, je vais sonner plus fort. Va vérifier … et éteindre ce début d’incendie !».
Ne pas écouter sa colère, tenter de la faire taire va souvent amener à des débordements émotionnels.
Quand on prend sur soi et qu’on n’exprime pas ou peu ses besoins ou ses limites, ou quand on les exprime d’une manière peu efficace, c’est comme si on essayait d’éteindre ce signal d’alarme.
La partie de nous qui trouve les choses inacceptables finit généralement par dire à la partie de nous qui veut qu’on reste calme : « bourre-toi de là que je m’y mette ! je vais te le résoudre le problème moi !!! »
Et boum, explosion ! Et on va exploser d’autant plus fortement qu’on aura tenté de contrôler longtemps.
Puis, la culpabilité associée à l’explosion nous conduit ensuite à renforcer notre tendance initiale à réprimer à la colère, à l’exprimer de manière peu efficace. Ce qui ne fait que préparer l’explosion suivante.
On rentre alors dans un cercle vicieux où on a des périodes d’accalmie, suivies d’explosions de plus en plus fortes, de plus en plus fréquentes.
J’en avais parlé dans cet article : « comment vouloir être bienveillante m’a (presque) rendue maltraitante »
Et quand on écoute sa colère, tout va bien alors ?
Il existe une autre manière de faire sonner trop fort le signal d’alarme de la colère : c’est d’insister alors même que le changement attendu n’est pas possible.
Quand votre demande est infructueuse, mais que vous persistez à insister, chaque répétition fait monter votre frustration, et donc votre colère. Au bout d’un moment vous n’êtes plus en capacité d’exprimer la demande de manière posée et acceptable.
C’est ce que j’avais décrit dans l’article « la carte de fidélité de la colère ».
Dans les relations interpersonnelles, quand vous vous exprimez d’une manière trop agressive, trop violente, vous avez souvent moins de chances d’être entendu par votre interlocuteur (rejet de la forme).
Si vous avez en face de vous une personne qui manque de confiance en elle, oui, elle va avoir peur et va faire ou essayer de faire ce que vous lui demandez.
Mais si la personne a confiance en elle, elle risque fort de vous envoyer sur les roses. Et évidemment cette réaction de rejet va augmenter votre colère et va vous conduire à exprimer encore plus vertement votre demande et donc à être moins entendu.
C’est typiquement ce mécanisme dont j’avais parlé dans cet article.
Mais là aussi on est dans une impasse.
Tout à l’heure c’était l’impasse de « je n’accorde pas assez de crédit d’importance à mes besoins, à mes limites« . Là l’impasse c’est, au contraire : « j’en accorde trop, j’agis trop mais sans résultat et je persiste à agir alors même que je me prends le mur à chaque fois ».
La colère augmente dans deux cas :.
- Quand on n’agit pas ou pas assez sur quelque chose qui pourrait être changé
- ou bien quand on continue à essayer d’agir sur quelque chose qui ne peut pas être changé.
Autrement dit : l’augmentation de la colère signale qu’on est en train de faire quelque chose qui ne marche pas.
Tout l’art de la régulation ça va être d’apprendre à distinguer entre les deux, c’est-à-dire ce sur quoi on doit continuer à insister, pour le faire de manière plus efficace et ce qu’on doit laisser tomber.
Ce n’est franchement pas simple mais c’est ce que je vais approfondir dans les deux prochains épisodes de cette série sur la colère .
Pour mémoire la série est constituée de :
- Une conversation sur la colère pour poser les bases
- un épisode de généralités pour reprendre les mécanismes de la colère (celui-ci)
- un épisode sur la colère chez les enfants, principalement les plus jeunes (pourquoi ils explosent, pourquoi ils font des crises, comment y réagir)
- un épisode sur la colère chez les parents : d’où elle vient et comment la réguler plus efficacement
Retranscription faite grâce à WhisperTranscribe (lien affilié)
Pour finir …
Ce contenu vous a été utile ? Vous pouvez me le faire savoir en me faisant un don ponctuel ou récurrent. Ces dons me permettent de libérer du temps pour produire plus de contenu gratuit et accessible à tous.
Vous avez besoin d’un accompagnement ? Découvrez en plus sur mes accompagnements. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous directement en ligne :
Vous pouvez vous abonner à ma newsletter pour avoir les informations des nouveaux articles et aussi les infos sur les prochaines conférences :
Crédits Photo : Freepik
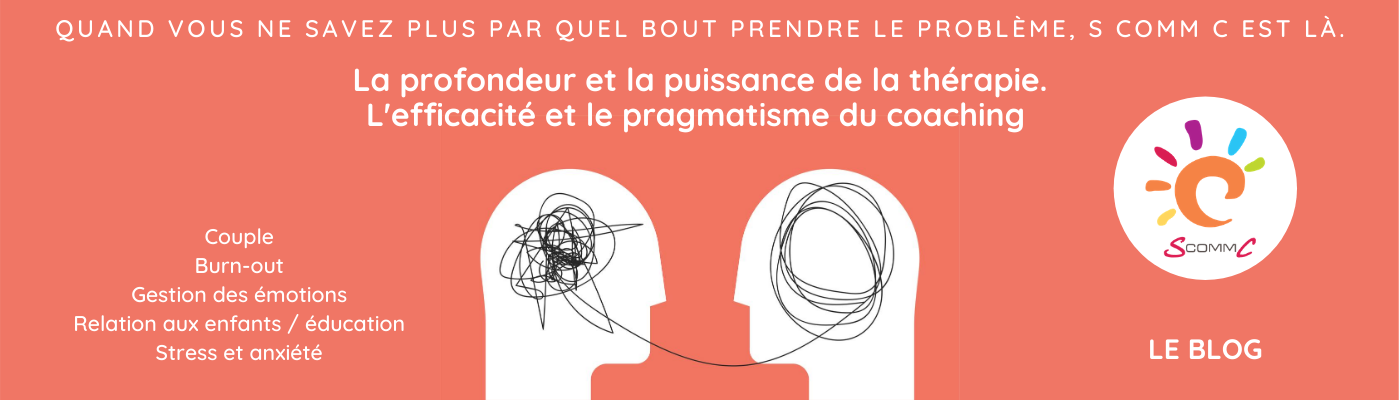
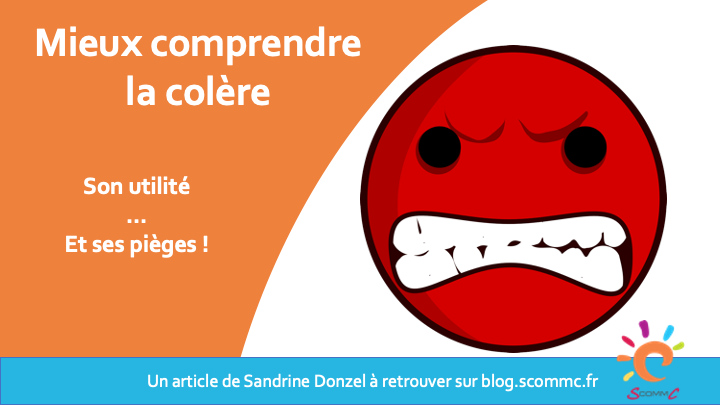

Ping :La colère chez les enfants - S Comm C, le blog
Ping :La colère chez les parents : comment s'énerver moins sur ses enfants ? - S Comm C, le blog
Ping :Conversation sur la colère - S Comm C, le blog
Ping :Comment communiquer dans le couple à propos de la charge mentale ? - S Comm C, le blog