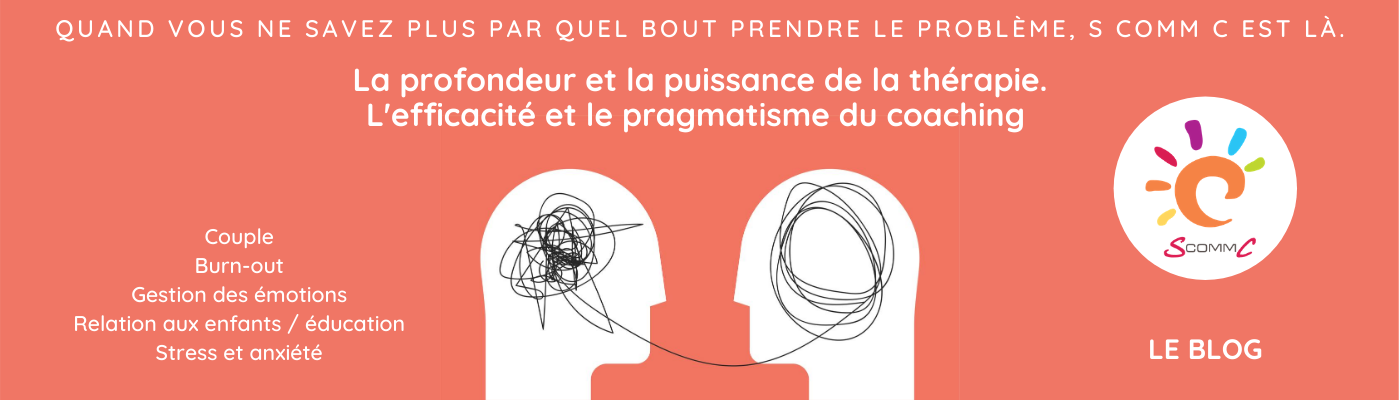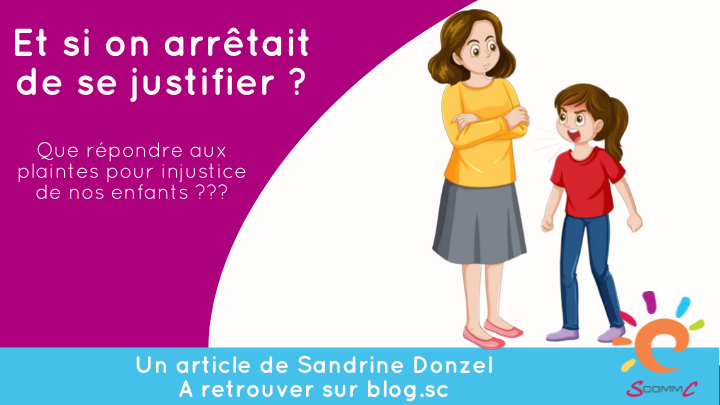Comment sortir du piège de la justification avec ses enfants ?
Aujourd’hui, on va parler d’un phénomène qu’on rencontre souvent quand on a des enfants – et encore plus quand ils grandissent : leur tendance à se plaindre de notre injustice, de notre sévérité, ou tout simplement … de nous.
C’est un sujet que j’avais commencé à aborder dans un épisode précédent, mais je me suis dit que ça méritait clairement un approfondissement. Parce qu’il y a matière.
Je parle des :
- “Mais c’est pas juste !”
- “Tu préfères mon frère !”
- “Moi t’as jamais voulu m’acheter de chaussures aussi chères !”
- “T’es toujours sur mon dos…”
- « T’écoutes jamais ce que je dis !”
- “Les parents de Léa, eux au moins, ils sont cools.”
Voilà. Ce genre de phrases qui ont le chic pour nous faire grimper au plafond ou soupirer très fort (ou les deux à la fois). Parce qu’au fond, on sait que ça va mal finir : qu’on va argumenter, se justifier, s’énerver peut-être … et qu’à la fin, ça ne fera plaisir à personne.
Alors dans cet épisode, on va voir ensemble :
Et surtout : qu’est-ce qu’on peut faire d’autre, pour garder un lien avec nos enfants, reconnaitre leur plainte sans pour autant accéder à toutes leurs demandes.
- Pourquoi on se justifie aussi vite et aussi souvent,
- Pourquoi, franchement, ça ne marche pas toujours (et même parfois, ça empire un peu tout),
Vous pouvez trouver l’épisode de podcast en audio ici ou lire la retranscription qui suit :

Ep. 21 et si on arrêtait de se justifier – Du côté des parents !
Pourquoi on se justifie autant quand on est parent ?
Alors déjà, soyons honnêtes : quand notre enfant nous dit qu’on est injuste, qu’on aime plus l’un que l’autre, ou qu’on ne l’écoute jamais … ça nous pique.
Et notre réflexe quasi immédiat, c’est souvent de se justifier.
“Non, je t’aime tout autant que ton frère, regarde : la semaine dernière, on a fait une sortie rien que toutes les deux.”
“Mais tu rigoles ? J’ai passé une heure à chercher des baskets pour toi hier soir !”
Ce réflexe est compréhensible. D’abord, parce que parfois, ça marche.
Ces arguments factuels peuvent effectivement faire revenir à la mémoire de l’enfant des moments qu’il avait oubliés sur le moment de sa frustration. Et peut-être que ça le convainc.
Mais … soyons honnêtes : c’est finalement assez rare.
Parce qu’en réalité, la plainte de l’enfant n’est pas factuelle, elle est émotionnelle.
… et c’est aussi une manière de dévier le sujet du problème qu’on est en train de traiter au départ. J’y reviens dans la suite de cet article !
Ce qu’il veut dire, ce n’est pas : “Démontre-moi par A + B que tu es équitable.”
C’est plutôt : “là maintenant tout de suite, , je ne me sens pas écouté, je me sens frustré, ou mis de côté.” ou “je suis triste, je suis en colère”.
C’est souvent une plainte sur le moment … et pas au global de la relation ! C’est ce point qu’on oublie dans les justifications : on parle d’une émotion ponctuelle, pas d’un sentiment général.
Evidemment face à une émotion, les chiffres, les preuves, les souvenirs ? Ça ne répond pas bien
Et puis parfois, la plainte est stratégique.
Parce que l’enfant a expérimenté que se plaindre d’injustice, ça peut rapporter gros !
Même si on est agacé, on adoucit la contrainte : on explique, on discute, on négocie. On est triste que l’enfant pense ça de nous, ça nous amène à arrondir les angles.
Et rien que ça, c’est déjà du temps rien que pour lui, et parfois des bénéfices. Même si ce comportement est involontaire et inconscient chez l’enfant, ces bénéfices l’incitent à retenter l’expérience de la plainte, même si ça finit parfois par des tensions.
On peut le dire comme ça : le “c’est pas juste” devient un bouton qui active “plus d’attention parentale”. Et certains enfants deviennent très doués pour appuyer dessus.
Cela dit, même si ce n’est pas toujours efficace, cette tendance qu’on a à vouloir rétablir la vérité et la justice … elle est plutôt chouette.
Elle montre qu’on n’a pas envie que notre enfant se sente abandonné, délaissé, ou traité injustement.
Et qu’on a, nous aussi, envie d’être un bon parent. Juste. Bienveillant. Disponible. Aimant.
Mais justement, la plainte de l’enfant vient souvent appuyer pile sur ce bouton rouge : “Tu n’es peut-être pas ce parent-là.”
Alors on veut démontrer que si, justement, on l’est ! Et qu’il n’a aucune raison de se sentir comme ça.
Et on sort les preuves, les dates, les tickets de caisse, les souvenirs. D’autant plus si nos compétences parentales nous angoissent.
Cette peur-là peut nous donner envie de démontrer que, si justement, on EST un bon parent. Un vrai procès-verbal d’équité parentale. Sauf que ce dossier de preuves envoie le message à l’enfant qu’il n’a aucune raison de se sentir comme il se sent.
Parce qu’il y a quelque chose qui gratouille derrière tout ça :
- la culpabilité de ne pas pouvoir tout faire,
- le doute permanent sur nos choix,
- et la peur d’avoir loupé un truc important sans s’en rendre compte.
Alors quand un enfant dit : “Tu préfères mon frère”, on cherche frénétiquement dans notre mémoire la dernière preuve qu’on l’aime pareil.
Et si on ne trouve pas assez vite, ça nous tord un peu le ventre. Et là, une petite voix commence à murmurer : “Si je n’arrive pas à le convaincre… c’est peut-être qu’il a raison, non ?”
Quel horrible doute !!!
Alors on empile les arguments en espérant enfin convaincre l’enfant. Et donc NOUS rassurer. Mais très souvent … ça ne marche pas mieux sur nous que sur les enfants.
Et parfois même, ça aggrave chez nous les doutes.
Et même si on n’a pas trop de doutes, empiler les arguments nous amène à penser que notre enfant est irrationnel et déraisonnable. Ce qui ne nous incite pas à mieux l’écouter et au contraire renforce la tendance à rationaliser ses plaintes.
Pourquoi expliquer et argumenter ne fonctionne pas ?
Parce que notre réponse ne correspond pas à la demande réelle. Ni à la situation réelle !!!
Comme je l’ai souligné précédemment, dans cette situation, l’enfant (ou l’ado) ne cherche pas un raisonnement.
Il cherche soit un espace pour dire : “Je suis en colère, je suis triste, je me sens frustré LA MAINTENANT TOUT DE SUITE”
Et nous, au lieu de répondre à cette émotion, on répond au contenu. Mais le problème, c’est ce qu’il ressent.
Et du coup, notre réponse tombe à côté.
Pire : elle peut lui donner l’impression qu’on rejette ce qu’il ressent. C’est cela qui l’incite à augmenter, amplifier sa plainte, pensant qu’elle sera mieux entendue si elle est dramatique.
Quand il dit : “Tu préfères mon frère”, et qu’on répond : “Mais pas du tout, regarde tout ce que je fais pour toi !”, il peut entendre : “Tu n’as aucune raison de ressentir ça.”
Et là, il insiste. Il hausse le ton. Il remonte d’un cran. Il devient blessant, injuste, exagéré …
Pas parce qu’il veut nous blesser, mais parce qu’il ne sent pas entendu.
C’est le moment où on passe dans une autre dimension : “De toute façon t’as toujours préféré mon frère, même quand j’étais bébé !”, “Moi je suis juste un boulet dans cette famille, c’est tout !”, “Tu sais quoi ? J’ai même plus envie de parler avec toi.”
Et là, on entre dans ce que j’appelle le tournoi de mauvaise foi, en finale directe.
À ce moment-là, on pourrait bien sortir toutes les preuves qu’on veut : rien ne fonctionnera.
Et plus on répond, plus ça monte pour parfois finir en vraie dispute.
Si on continue d’argumenter ça peut même finir en vraie dispute. Quand on est à cours d’argument, le seul moyen de couper une conversation stérile, c’est soit d’argumenter, soit de dire des choses blessantes.
Qui nous fait encore plus culpabiliser et douter … et encore plus argumenter la fois suivante, sans jamais faire ressentir à l’enfant qu’on a compris sa frustration ou sa tristesse du moment. Ni prendre le temps d’avoir une vision plus globale de la relation.
Un des signes qu’il est temps de cesser d’argumenter, c’est quand l’enfant commence à avoir des arguments assez peu rationnels, qu’il exagère visiblement et qu’on est obligés de s’énerver pour mettre fin à la discussion.
Cela signifie qu’on a basculé dans l’irrationnel et l’émotionnel et qu’il est à peu près impossible de convaincre l’enfant avec des arguments rationnels.
Que ce soit un adulte ou un enfant, quand quelqu’un a basculé dans l’émotionnel, cette personne est impossible à convaincre avec des arguments rationnels.
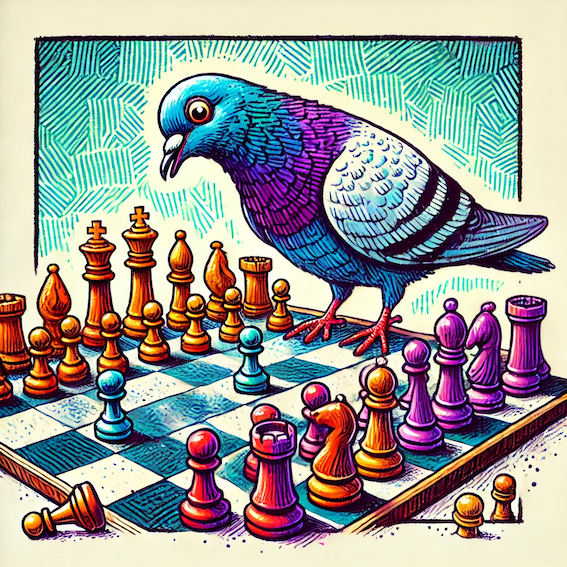
Comme on dit : C’est un peu comme si tu étais en train de jouer aux échecs avec un pigeon.
Tout ce qu’il fait, c’est renverser les pièces, fait caca sur l’échiquier !
A ce stade – et même avant – ça vaut la peine d’arrêter de jouer sinon vous allez abimer l’échiquier et avoir envie de faire rôtir le pigeon à la broche !!! (surtout que l’échiquier, c’est votre relation et le pigeon, c’est votre enfant !)
Chez les ados, cette dynamique est encore plus flagrante, souvent plus du côté de la manipulation involontaire.
Pour nous faire réagir, les ados sont très forts pour construire une version fantasmée du parent idéal, un hybride de tous les parents des copains : celui qui laisse sortir tard, celui qui paie les fringues de marque, celui qui ne râle jamais, etc
Et face à ça, quoi qu’on dise, on a perdu d’avance.
Bon déjà parce que ce parent chimérique n’existe pas : celui qui laisse sortir tard dit non pour les fringues de marque, celui qui est no limite sur les temps d’écrans n’accepte pas les sorties, etc
Mais que ce soit par confort ou par réelle frustration ou tristesse, argumenter avec quelqu’un qui n’est pas rationnel est inefficace. Tout le monde finit épuisé, incompris, et parfois même blessé aussi bien le parent que l’enfant
Alors non, se justifier n’est pas toujours une mauvaise chose.
Mais dans certaines situations, ça n’a aucune chance d’aboutir.
Et à ce moment-là, il vaut mieux faire autre chose.
Mais quoi ?
Qu’est-ce qu’on peut faire à la place de se justifier ?
Quand on se rend compte qu’argumenter ne mène à rien – ou que ça tourne en rond, ou que ça dégénère – il vaut mieux changer de stratégie.
Et non, ce n’est pas fuir.
C’est sortir d’une impasse pour garder un lien qui fonctionne, tout en posant un cadre qui tient compte aussi de nos besoins.
Voici quelques pistes concrètes à tester :
Accueillir la plainte sans la corriger
Je commence par le plus simple (et souvent le plus efficace) : écouter vraiment ce que l’enfant ressent, sans tenter de le faire changer d’avis.
Parce que dans 90 % des cas, ce n’est pas la vérité historique que l’enfant cherche.
C’est juste à dire : “Je suis frustré, triste, en colère, je me sens mis de côté.”
Et ce qui aide vraiment dans ces moments-là, c’est qu’il sente qu’on a entendu son émotion : “Tu trouves ça injuste, à ce point-là ?”, “Tu aurais vraiment préféré avoir un manteau plutôt que des chaussures ?”
Et c’est tout. Pas besoin d’ajouter : “Mais non, regarde, en 2019 tu avais eu…”
Juste accueillir.
Parce que – comme je l’ai déjà expliqué dans d’autres épisodes et sur le blog :
l’écoute ne supprime pas la frustration, mais elle donne du courage à l’enfant pour faire avec.
Attention l’écoute ne résoud pas le problème : si l’enfant est frustré, il reste frustré. Le seul moyen qu’il ne le soit plus du tout, c’est de lui donner ce qu’il veut. Mais l’écoute, l’empathie lui donnent du courage pour surmonter la frustration.
Je vous mets ici les liens des épisodes et articles à propos de l’écoute active. Ils vous donneront des outils pour ces situations :
- L’escalade de la coopération
- Comment marche l’écoute active
- La posture et les freins à l’écoute active
- Les limites de l’écoute
- les clés pour une bonne écoute
Mettre en place un “bureau des plaintes”
Deuxième outil : le bureau des plaintes.
Un moment ritualisé en fin de journée où l’enfant peut exprimer tout ce qu’il a sur le cœur …
Et où on n’argumente pas, on écoute. Avec bienveillance. Et avec un vrai souci de justice – en se demandant en quoi cette demande est légitime ou justifiée.
“T’as le droit de dire ce que tu veux. Je ne vais pas discuter, je vais juste t’écouter.”
Ca nous permet d’être pleinement disponible parce qu’on n’est pas contraint par le temps. Mais aussi parce qu’on s’oblige à ne faire qu’une chose à la fois = ECOUTER uniquement et pas répondre.

Et là on entend des choses comme : “Y en a marre de ranger ma chambre.”, “T’écoutes jamais rien.”, “T’as l’air de préférer quand je suis pas là.”
Ok. On écoute.
Et rien que le fait de pouvoir dire ce qu’on ressent sans avoir à se battre pour ça, sans que le parent cherche à prouver qu’on a tort de ressentir ce qu’on ressent, l’enfant ressent qu’il est écouté jusqu’au bout et ça aide. Beaucoup.
Ca diminue l’intensité de la frustration ou de l’injustice ressentie.
Et puis, souvent, en allant au bout du reproche, on se rend compte qu’il y a des choses fondées. Des vraies frustrations. Des attentes pas toujours exprimées autrement.
Et puis surtout, c’est un outil qui désamorce les plaintes en boucle et qui aide l’enfant à différer ses ressentis : “J’ai pas besoin de tout balancer à chaud. J’ai un espace où je pourrai le dire.”
Les enfants n’ont pas besoin qu’on soient disponibles 100% du temps, mais bien de savoir qu’on est là s’il y a besoin.
Ramener la discussion sur le vrai sujet
Parfois, la plainte détourne le sujet initial : l’enfant ressent une frustration et il se plaint.
Et si on n’y prend pas garde, cette plainte nous emmène dans un terrain glissant : celui où on culpabilise … et où on finit par céder, par adoucir, ou par renoncer à poser un cadre clair. On va finir par se défendre au lieu de résoudre le problème de départ.
Exemple :
L’enfant veut négocier un temps d’écran.
- On dit non.
- Et il part sur : “Tu préfères mon frère, à lui tu dis toujours oui !”
- Et nous, on sent arriver les explications : “Oui mais il est plus grand”, “Oui mais il en a besoin pour le collège”, “Oui mais lui il ne pique pas une crise quand on arrête”…
Même si c’est vrai, même si nos arguments sont fondés, on est sorti du sujet.
Au lieu de rester sur une question concrète – le temps d’écran – on est maintenant en train de justifier notre amour, notre équité, notre gestion émotionnelle…
Bref : au lieu de résoudre un problème concret, on cherche à justifier un truc injustifiable. Il y aura TOUJOURS quelque chose à se reprocher (et c’est normal).
Alors dans ces cas-là, on recadre : “Là, il n’est pas question d’amour. On est en train de parler de savoir si oui ou non tu peux avoir du temps d’écran en plus ce week-end.”
Juste ça. Et ça suffit à remettre de la clarté dans l’échange. A recentrer sur le bon sujet et à éviter de se laisser embarquer dans autre chose.
Les enfants comprennent très bien l’intérêt qu’il y a à revenir sur le sujet de base si on ne se laisse pas embarquer dans autre chose.
Savoir couper court quand c’est nécessaire
Et si malgré tout ça, l’échange tourne en boucle, devient toxique, ou simplement trop tendu, on peut choisir d’y mettre fin. Gentiment. Fermement. Et surtout, en assumant.
“On cherche à savoir quel est ton temps d’écran pour ce soir, pas à savoir si j’aime plus ton frère que toi. Si tu veux discuter du temps d’écran, je suis disponible. Si non, je vais faire la cuisine. Reviens me voir quand tu seras disponible pour en parler.”
Évidemment, il va râler. Peut-être même criser. Mais vous n’êtes pas obligé de réagir.
Un simple : “Et j’ai bien compris que tu étais fâché contre moi pour le moment. Quand tu voudras parler du temps d’écran, tu pourras venir me voir.” suffit.
“Je crois que j’ai déjà répondu à ta question.” permet aussi de mettre fin à des plaintes en boucle.
Couper court, c’est une façon de se protéger de nous même = on s’évite de finir par faire des choses qu’on regrette.
De rester calme pour pouvoir être à nouveau disponible … plus tard. Ce n’est pas fuir. Ce n’est pas abandonner la discussion. C’est choisir une autre modalité, un autre moment, plus juste et plus respectueux pour chacun.
En conclusion : comment on sort de la justification et des argumentations stériles avec ses enfants ?
Vous l’aurez compris : non, se justifier n’est pas forcément une erreur. Expliquer, Parfois, ça éclaire. Parfois, ça rassure.
Mais dans pas mal de situations – surtout quand la plainte est chargée d’émotion ou répétée – ça ne fonctionne pas.
Et pire : ça entretient l’idée qu’on devrait prouver qu’on est un bon parent, à chaque contrariété …
Ce qui est, soyons honnêtes, une pente glissante, très épuisante, et souvent totalement inefficace. C’est comme essayer de remplir un puits sans fond.
L’enfant n’a pas besoin qu’on justifie chaque décision. Ils n’ont pas besoin de savoir qu’on est juste et équitable à chaque instant.
Ils ont besoin de ressentir que globalement ils sont en sécurité dans cette relation, qu’ils peuvent s’exprimer si quelque chose ne va pas.
Ne transformez pas chaque désaccord en débat sur votre valeur parentale.
Et ce n’est pas simple, je le sais bien.
Parce qu’on voudrait tellement que nos enfants sachent à quel point on fait de notre mieux. Et puis, nous aussi, parfois, on aurait besoin que quelqu’un nous dise : “T’inquiète, tu es un bon parent !”
(Et on ne va pas se mentir : on aimerait bien que ça vienne de nos enfants.)
Si vous en avez besoin : vous pouvez imprimer cette phrase “t’inquiète tu es un bon parent” et l’afficher sur votre frigo !!!
Mais si vous avez à cœur d’écouter vos enfants, et de faire en sorte qu’ils se sentent aimés et respectés, alors une bonne partie du travail de parent est déjà faite.
Je vous propose de tester, dans les jours qui viennent, une autre manière de faire si vous sentez que vous vous justifiez trop et que ça tourne en boucle.
Et si vous avez envie de partager vos expériences, vos doutes ou vos trouvailles, vous pouvez le faire dans les commentaires (ou par mail si vous voulez le faire en toute discrétion).
Merci pour votre écoute, et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le dernier épisode de la première saison de « Du Côté des Parents ! »
Pour finir …
Vous pensez avoir besoin d’un accompagnement ? Découvrez en plus sur mes accompagnements. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous directement en ligne :
Vous pouvez vous abonner à ma newsletter pour avoir les informations des nouveaux articles et aussi les infos sur les prochaines conférences :
Ce contenu vous a été utile ? Vous pouvez me le faire savoir en me faisant un don ponctuel ou récurrent. Ces dons me permettent de libérer du temps pour produire plus de contenu gratuit et accessible à tous.