Comment accompagner les peurs des enfants : conseils concrets pour les parents
Comment accompagner les peurs des enfants sans les minimiser ni les renforcer ? C’est une question que beaucoup de parents se posent. Dans cet article et épisode de podcast, j’échange avec Marina Blanchart, psychologue, sur ce sujet. Vous trouverez dans cet article des pistes concrètes pour mieux comprendre ces peurs et aider vos enfants à les traverser avec confiance.
Voici aussi l’épisode de podcast en audio, accessible sur toutes les plateformes :

Ep. 17 Accompagner les peurs des enfants – Du côté des parents !
Comment accompagner les peurs des enfants, un sujet fréquent en accompagnement parental
Aujourd’hui, j’aimerais vous parler d’un sujet qui revient souvent chez les parents : les peurs des enfants.
Certaines de ces peurs nous parlent, parce que nous les partageons avec eux. D’autres, au contraire, nous semblent complètement irrationnelles, voire absurdes. Et face à tout ça, on ne sait pas toujours comment réagir.
La peur des monstres, du noir, des insectes, la peur d’être séparé de ses parents… Il en existe une grande variété. Parfois, ces peurs disparaissent toutes seules. D’autres fois, elles s’installent plus durablement.
Pour mieux comprendre ces peurs, et savoir comment y répondre de façon à la fois efficace, constructive et bienveillante, j’ai invité Marina Blanchart.
Marina est psychologue, spécialiste du modèle de Palo Alto – le même que celui que je pratique – et fondatrice de l’Institut Virages Formation.
Elle consulte depuis maintenant 24 ans. Elle accompagne un public très varié, mais ce qui la touche particulièrement, ce sont les questions familiales, et bien sûr, les parents. Ce sont des figures centrales dans sa pratique, parce qu’ils arrivent souvent avec cette volonté très forte de bien faire.
Elle en parle avec beaucoup de justesse, et aussi avec une expérience personnelle précieuse : elle est aussi maman de quatre enfants.
Elle sait, de l’intérieur, à quel point la parentalité peut devenir un objectif de vie presque sacré. On a tous envie de réussir ça, plus que tout… et pourtant, ce n’est pas toujours simple. Les conseils fusent dans tous les sens, et ce n’est pas facile de s’y retrouver.
Sur ce point-là, je la rejoins complètement ! Je crois qu’avec Marina, on partage une grande tendresse pour les parents. Et aussi beaucoup de compassion pour ce qu’ils vivent aujourd’hui, dans un monde où ils sont sans cesse tiraillés entre des injonctions contradictoires : faites comme ci, non, plutôt comme ça … C’est souvent déroutant, parfois épuisant.
Alors dans cet article, comme d’habitude sur ce blog, on va essayer de faire autrement et éviter les recettes toutes faites et les conseils qui culpabilisent.
Un rappel : la peur est une émotion utile
Sandrine — Ce que je te propose pour commencer, c’est de partir d’une question assez large sur les peurs. Peut-être se demander : est-ce qu’il y a des peurs normales, et d’autres plus problématiques ?
Et plus largement, à quoi ça sert, la peur ? Qu’est-ce que c’est, au fond, la peur ?
Marina — Si on parle de la peur, je crois qu’il faut d’abord rappeler que c’est une bonne émotion. Même si elle n’est pas agréable à vivre. C’est important de le dire, parce que beaucoup d’émotions désagréables — et la peur en fait partie — sont mal vues. On n’aime pas trop les ressentir nous-mêmes, et encore moins voir nos enfants y être confrontés.
On voudrait les en protéger, presque instinctivement.
Alors que justement, la peur est là pour nous protéger.
Et c’est un peu paradoxal : on a peur que nos enfants aient peur… parce qu’on veut les protéger de ce qui est censé, en réalité, les aider à se protéger.
Je dis souvent aux parents : vous vous en servez vous-mêmes avec vos enfants. On leur apprend à avoir peur de traverser n’importe comment, à se méfier d’un chien inconnu, à ne pas grimper trop haut … On utilise la peur pour les protéger, pour leur apprendre à évaluer un danger.
Donc on sait qu’elle a une fonction utile.
Mais c’est vrai que parfois, elle nous complique un peu la vie … comme le soir, au moment du coucher. On est fatigué, on a envie que la journée se termine, et là, on se retrouve avec un enfant qui a peur, parfois même terrorisé. C’est dur à voir.
Alors on a très envie de faire disparaître cette peur au plus vite — et, dans cet élan, on oublie un peu qu’elle peut aussi avoir son utilité.
Rassurer et protéger : des stratégies fréquentes et logiques pour accompagner les peurs des enfants … mais pas toujours efficaces
Sandrine — qu’est-ce que tu observes dans les réactions des parents face aux peurs de leurs enfants ? Est-ce qu’il y a des éléments qui posent problème, des façons de faire qui, clairement, ne fonctionnent pas ?
Marina — Pour moi, il n’y a pas vraiment de « ça ne marche jamais ». Je crois que tout mérite d’être essayé, et j’encourage toujours les parents à suivre d’abord leur instinct.
Si ça fonctionne, tant mieux. Mais — et c’est là que ta question est très juste — si ça ne marche pas, alors il faut changer de stratégie. Parce que continuer à faire ce qui ne fonctionne pas, ce n’est jamais neutre.
Au contraire, ça peut entretenir une dynamique qui renforce la peur chez l’enfant. Et évidemment, ce n’est pas du tout ce qu’on cherche à faire.
Ce que j’observe le plus souvent, c’est que la première réaction des parents, face à la peur de leur enfant, c’est de vouloir rassurer. Et c’est assez naturel : comme je le disais tout à l’heure, voir son enfant avoir peur, ce n’est pas agréable. Alors on essaye, en quelque sorte, de mettre un couvercle sur cette peur, de la faire disparaître rapidement.
Souvent, ça passe par le raisonnement : on tente d’expliquer, de relativiser, de prouver que la peur n’a pas lieu d’être. Et évidemment, ça dépend aussi du type de peur.
Tu posais la question tout à l’heure, et je ne t’avais pas encore répondu là-dessus : c’est vrai que certaines peurs sont plus faciles à gérer que d’autres.
Par exemple, la peur des monstres : c’est souvent plus simple, parce qu’on peut dire “ça n’existe pas”, ou “ils ne sont pas là”. Même si, entre nous, on n’est jamais tout à fait sûrs qu’ils n’existent pas.
Mais la peur de la mort, par exemple, c’est autre chose. Là, même nous, adultes, ça peut nous faire peur. Et dans ce cas-là, on a encore moins envie que notre enfant ressente ça … donc on essaie encore plus fort de le rassurer, et de faire taire cette peur.
Et pourtant … rassurer peut fonctionner. Je le dis toujours aux parents : parfois, ça marche très bien.
Avec un premier enfant, par exemple, on met une veilleuse, on explique qu’il n’y a pas de monstres, et tout se passe bien. Mais avec un deuxième, on peut faire exactement la même chose, et là… rien n’y fait. Il a besoin qu’on reste à côté, il nous rappelle mille fois, il ne peut pas s’endormir tant qu’on n’est pas là.
Donc oui, rassurer est souvent la première réponse qu’on apporte, et parfois, ça suffit. Mais pas toujours.
Évidemment, quand les parents viennent nous consulter — toi comme moi, Sandrine — c’est souvent parce que ça n’a pas marché. C’est important de le dire : rassurer ne fonctionne pas toujours.
Et c’est justement ce qu’on va essayer de creuser ensemble : pourquoi ça ne marche pas dans certains cas, et surtout, comment faire autrement.
Un autre réflexe très courant, c’est celui de protéger l’enfant. Par exemple, un enfant qui a peur des chiens : les parents vont le prendre dans les bras dès qu’un chien approche. Et parfois, ça suffit ! L’enfant grandit, la peur diminue, et un jour, plus besoin de le porter, tout va bien.
Mais ça peut aussi avoir un effet inverse. À force de le prendre dans les bras, l’enfant peut comprendre : “si on me protège comme ça, c’est que les chiens sont vraiment dangereux.”.
Donc, même si l’intention est d’aider, le message implicite, c’est que le danger est réel.
Souvent, on aide notre enfant à éviter ce qui lui fait peur. Et c’est logique : on ne veut pas qu’il souffre, et on sait bien que, nous aussi, quand on a peur, le réflexe, c’est d’éviter. Alors on fait pareil pour lui.
Et effectivement, sur le moment, ça apaise. Mais sur le long terme, ça peut entretenir l’idée que la peur est justifiée, et surtout, que l’enfant n’est pas capable d’y faire face. Donc ce n’est pas forcément aidant. Ou en tout cas, pas toujours.
Sandrine — Ce que tu viens de dire fait vraiment partie, pour moi aussi, des points essentiels. Ce que tu soulignes, c’est que rassurer l’enfant, ou même minimiser sa peur — en disant par exemple “mais non, ne t’inquiète pas, ce n’est pas grave” ou “les monstres, ça n’existe pas, regarde, il n’y en a pas” — ça peut tout à fait fonctionner.
De la même manière, aider l’enfant à éviter l’objet de sa peur peut aussi être très efficace. Ça envoie à l’enfant un message fort : “je suis là pour toi, si tu as peur, j’interviens.”. Et c’est un message très rassurant, très sécurisant, surtout pour les plus petits.
Mais peut-être que là où ça peut devenir problématique, c’est si ces stratégies deviennent systématiques en grandissant. C’est à ce moment-là qu’elles risquent de limiter l’enfant, au lieu de l’aider à faire face.
Marina — Exactement, oui. Parce qu’en fait, on finit presque par affaiblir notre enfant, sans le vouloir. L’évitement est le mécanisme à la base de la phobie.
À force de vouloir le protéger, on ne lui permet pas de faire face à sa peur. Du coup, il n’apprend ni à gérer ce qu’il ressent, ni à affronter ce qui lui fait peur. Et ça, dans les deux cas, ça peut le rendre plus vulnérable par la suite.
Or bien sûr, ce n’est pas du tout ce qu’on souhaite. On veut qu’il se sente capable, pas qu’il reste dépendant de nous ou de stratégies d’évitement.
Quand rassurer son enfant face à sa peur ne suffit plus, que faire ?
Sandrine — Ce que les parents me décrivent souvent — et je pense que tu entends la même chose dans ta pratique — c’est qu’ils ont essayé plein de choses : rassurer, expliquer, écouter…
Mais l’enfant continue d’avoir peur, il ne devient pas “raisonnable”, en tout cas pas comme ils l’espéraient. Et ça, c’est particulièrement vrai pour les peurs que les adultes perçoivent comme irrationnelles.
Alors, au bout d’un moment, ils s’énervent. Ils savent bien que ce n’est pas très bienveillant, que ce n’est pas ce qui va aider leur enfant à aller mieux… mais ils se sentent démunis. Donc la vraie question, c’est : qu’est-ce qu’on peut leur proposer à ce moment-là ?
Marina — Alors moi, ce que je propose souvent aux parents, c’est de commencer par poser une question toute simple : “Votre enfant a peur … d’accord, mais il a peur que le monstre fasse quoi, exactement ?”
Et en général, les parents ne savent pas répondre. Ils n’ont jamais posé la question, parce qu’ils ont très vite répondu : “Mais non, il n’y a pas de monstre, regarde sous ton lit, tu vois bien qu’il n’y a rien.”
En fait, ils n’ont jamais vraiment écouté la peur. Donc en posant cette question, j’essaie de leur faire prendre conscience qu’ils ne connaissent pas cette peur-là, et que ça pourrait être intéressant de l’explorer avec leur enfant.
Souvent, le réflexe des parents, c’est d’empêcher l’enfant de ressentir la peur. Et c’est tout à fait légitime, encore une fois : personne n’a envie de voir son enfant avoir peur. Mais quand ça ne marche pas, quand la peur persiste, il va falloir aller la regarder de plus près, essayer de comprendre ce qu’elle raconte.
Et comme on le disait tout à l’heure, certaines peurs, on les utilise nous-mêmes pour protéger nos enfants — traverser la rue, se méfier d’un chien inconnu … Donc peut-être que, même dans une peur qui semble irrationnelle, il y a un message intéressant à aller chercher.
Et peut-être aussi qu’il n’y a aucune logique derrière, mais ça vaut quand même la peine d’aider l’enfant à regarder sa peur en face : « Le monstre, il vient d’où ? Il ferait quoi ? » Décortiquer, poser des questions … jusqu’à ce que l’enfant puisse, par lui-même, relativiser.
Parce que si on rationalise trop vite — “ça n’existe pas” — l’enfant se sent obligé de défendre sa peur. Même s’il ne le dit pas explicitement, il se dit intérieurement : “Papa et maman ne comprennent rien. C’est encore plus inquiétant.”
Alors que s’il explore avec nous ce qui lui fait peur, il peut trouver ses propres réponses.
Je me souviens d’un enfant qui m’avait dit : “Moi je vais mettre mon stick de hockey sous le lit, comme ça s’il y a un monstre, je me défends.” C’était son idée, et ça l’a apaisé. Jamais je n’aurais pensé à proposer ça moi-même !
Mais c’est ça l’idée : mieux connaître “l’ennemi” permet d’en avoir moins peur. Plutôt que de le diaboliser, on le remet à sa juste place. Et parfois, on se rend compte que ce n’était qu’un fantôme.
Et comme souvent avec les fantômes, quand on les regarde de près, ils disparaissent.
C’est ce qu’on conseille aux parents : prendre le temps de regarder la peur avec leur enfant, plutôt que de la fuir.
Comment faire face à la peur : des exemples concrets
Sandrine — Ce que tu dis me fait penser à une situation que j’ai accompagnée, qui ressemble beaucoup à ce que tu décris.
Le garçon qui avait peur de la trappe du grenier
C’était un garçon de 10 ans, qui avait peur de rester seul à l’étage, surtout le soir, au moment du coucher.
Ses parents avaient mis en place tout un rituel : ils montaient avec lui, restaient à ses côtés … Il y avait beaucoup de collaboration autour de sa peur, avec l’idée : “le pauvre, il a peur, c’est normal, on va rester là jusqu’à ce que ça passe et qu’il s’endorme.”
Mais lui, justement, il avait envie que ça passe. Il ne défendait pas sa peur, au contraire : elle l’inquiétait. Il faisait confiance à ses parents qui lui disaient que c’était un peu irrationnel, mais comme ils restaient malgré tout, il se disait : “Alors c’est peut-être moi qui ne suis pas normal…”. Et il a commencé à avoir peur … de ne pas être normal.
Alors on a été voir ce qu’il y avait vraiment derrière cette peur. Et c’est là que ça devient intéressant pour les parents : ce garçon avait peur de la trappe qui menait au grenier. Il imaginait que quelqu’un pourrait entrer par là, un intrus qui viendrait agresser la famille ou cambrioler la maison.
Chaque fois qu’il entendait un bruit, il se disait : “C’est irrationnel, je ne devrais pas avoir peur.” Mais il se cachait sous sa couette, paralysé, incapable de s’endormir.
Alors on a concrétisé la peur, comme tu l’expliquais tout à l’heure. Je lui ai dit : “Je ne sais pas comment quelqu’un pourrait passer par là, mais imaginons que ce soit possible … La trappe, elle est où exactement par rapport à ta chambre ?”
Il a dessiné le plan de la maison, on a regardé ensemble. Je lui ai demandé : “Si quelqu’un entre par cette trappe et que tu entends un bruit, qu’est-ce que tu fais ?”. Et il m’a dit : “Comme la trappe est loin, si j’entends le bruit suffisammen tôt, j’aurais le temps de fuir. Je descends les escaliers.”
“Et après, tu fais quoi ?”
“Je sors, je vais chez les voisins. Il y a des maisons tout autour.”
Et puis, il a ajouté : “Je vais prendre un couteau dans la cuisine, le mettre sous mon lit, au cas où.”
Comme ton exemple du stick de hockey ! Et il le reposait à la cuisine le matin en partant.
Il a fait ça plusieurs soirs. Et un jour, il s’est endormi sans penser à prendre le couteau.
Il l’avait tout simplement oublié. Et au rendez-vous suivant, il est arrivé en disant : “Tu sais Sandrine j’ai oublié mon couteau un soir … et finalement… ça va : je n’ai plus tellement peur.”
C’était vraiment un cas d’école. Et ça montre bien que, parfois, regarder la peur en face, en la détaillant concrètement, ça permet à l’enfant de reprendre du pouvoir… et peu à peu, la peur s’éteint.
Apprendre à affronter sa peur : devenir détective des bruits de la maison
Marina — Oui, c’est exactement ça. Tu l’as aidé à regarder sa peur en face, et en même temps, tu l’as soutenu dans cette démarche. Et c’est vrai aussi que les peurs évoluent avec l’âge.
Ton exemple m’a fait penser à quelque chose qu’on retrouve souvent : les bruits dans la maison. C’est un grand classique.
Souvent, les enfants essaient de ne surtout pas les entendre, ces bruits. Et les parents leur disent : “Mais arrête de les écouter, ce ne sont que des bruits, ce n’est rien.” Mais moi, je propose souvent l’inverse : je leur dis “Écoute-les bien.”
Je propose à l’enfant de devenir un détective du bruit, pendant quinze jours par exemple.
Et on se revoit après, pour faire le point. L’idée, c’est qu’il écoute vraiment tous les bruits de la maison, qu’il les identifie : “Ça, c’est le parquet quand papa monte l’escalier, ça, c’est le radiateur qui fait des glouglous dans la cuisine…”
Je leur explique : “Plus tu deviens expert de ces bruits, plus tu sauras reconnaître ceux qui sont normaux. Et s’il y avait un bruit vraiment inquiétant, tu pourrais le repérer facilement.”
Parce que quand on essaie de ne pas entendre, tout devient suspect. On ne sait plus faire la différence entre un bruit banal et un bruit inquiétant.
Et donc là encore, on est dans le même mouvement : faire face à ce qui fait peur, l’observer, l’apprivoiser. Et souvent, à force de bien le connaître, ça fait beaucoup moins peur. On se rend compte qu’il n’y a pas de vrai danger.
Sandrine — Oui, c’est exactement ça. En fait, on peut le formuler comme ça : il s’agit de réutiliser la fonction de la peur.
Plutôt que de se dire “je ne devrais pas avoir peur” ou “c’est irrationnel d’avoir peur”, on peut se dire :
“La peur est là pour me protéger.”. Et si elle s’active quand j’entends un bruit, alors c’est peut-être intéressant d’aller voir ce que ces bruits me disent.
Je peux apprendre à m’en servir pour me prémunir, pour comprendre ce qui se passe autour de moi.
Autrement dit, au lieu de lutter contre la peur, je l’utilise comme un signal, une ressource.
Et donc, je vais m’intéresser aux bruits, les observer, les identifier.
Marina — Oui, tout à fait. On peut aussi expliquer aux enfants que, plus ils écoutent les bruits, plus ils deviennent experts. Et à un moment, comme tu le disais, ils n’ont même plus besoin d’y faire attention consciemment.
Le cerveau reconnaît les sons familiers, il les classe comme non dangereux, et il finit par ne plus vraiment les entendre. Ils passent en arrière-plan, parce qu’ils sont repérés et enregistrés comme “sans danger”.
C’est un peu comme ça qu’on reprend le contrôle sur la peur : en allant vers elle, en l’explorant, on l’apprivoise, on l’intègre. Alors que si on dit à l’enfant “n’écoute pas”, ce qui est souvent dit avec de très bonnes intentions, ça a l’effet inverse : il se met à écouter encore plus, et les bruits prennent encore plus de place.
Face à la peur des enfants, le paradoxe de la protection parentale
Marina — Et puis, il y a aussi quelque chose d’important du côté des parents. Tu parlais tout à l’heure du fait que beaucoup restent près de leur enfant pour l’aider à se calmer, à s’endormir … Et c’est vrai, on le voit très souvent.
Dans ce type de situation, quand les parents sont présents en séance, ce que je fais parfois, c’est leur poser une question toute simple : “Et vous, est-ce que vous avez peur des bruits ?” Généralement, ils me répondent non, bien sûr.
Alors je leur dis : “Mais si vous n’avez pas peur… pourquoi allez-vous quand même près de lui ?”
Parce que ce qu’il faut comprendre, c’est que le fait d’être présent renvoie un message à l’enfant.
Sans le vouloir, on confirme la peur. On dit : “Tu as raison d’avoir peur, puisque je reste là pour te protéger.”
Prenons un exemple classique : un enfant a peur d’un monstre ou d’un truc qu’il a vu dans un film.
Les parents n’y croient pas une seconde, mais ils restent à côté de lui, parfois lui tiennent la main jusqu’à ce qu’il s’endorme.
Et ce geste, aussi bienveillant soit-il, envoie malgré tout un double message : “Je t’aime, je suis là pour toi.”Mais aussi : “Tu n’es pas capable d’être seul » ET « il y a peut-être un danger.”
Et ce message-là, les parents ne s’en rendent pas toujours compte. Alors que, dans les faits, ils confirment la peur, même s’ils sont animés par les meilleures intentions du monde.
Sandrine — Oui, c’est exactement ça, c’est le paradoxe de la protection. Souvent, en tant que parent, on n’en a pas conscience, parce qu’on se dit — à juste titre — que notre rôle, c’est d’être là pour notre enfant.
Le soutenir, lui montrer qu’on l’aime, qu’on est présent, qu’il peut compter sur nous quand il a besoin.
Et c’est vrai ! C’est fondamental dans la relation. Mais justement, c’est ce qui rend la chose si difficile à lâcher.
Parce qu’on a l’impression que si on ne reste pas près de lui, on ne joue pas notre rôle. Alors que parfois, être présent autrement — en aidant l’enfant à affronter ce qui lui fait peur — peut être plus aidant à long terme.
Quand arrêter de rassurer renforce la confiance en soi de l’enfant
Marina — Encore une fois, l’idée n’est pas de lâcher complètement la présence, tout le temps.
Mais parfois, il suffit de changer légèrement le message. Par exemple, pour un enfant qui a peur à l’étage, on peut lui dire : “Moi, je ne viendrai pas, parce que je n’ai pas peur. Je pense qu’il n’y a aucun danger. Mais si toi tu as peur, tu peux descendre.”
Et déjà, ça change la dynamique. C’est l’enfant qui doit faire l’effort, sortir de son lit. Ce n’est pas aussi confortable. L’inconfort change de camp, en quelque sorte.
Les parents n’ont plus à monter et descendre sans arrêt. Et en même temps, le message implicite transmis à l’enfant, c’est : “Moi, j’ai confiance. Tout va bien. Mais si tu as besoin, je suis là.”
On ne nie pas sa peur, mais on ne l’alimente pas non plus en venant systématiquement. Et ça permet de répondre à son besoin de sécurité, sans entrer dans une routine où c’est toujours le parent qui agit.
Parce que sinon — même si ce n’est évidemment pas volontaire ni conscient — ça peut devenir presque agréable d’avoir peur. L’enfant y trouve certains bénéfices : attention, présence, proximité…
Et tout ça peut, malgré lui, entretenir la peur.
Sandrine — Moi, j’ai envie d’aller un peu plus loin sur ce que tu viens de dire, parce que je trouve que c’est un point vraiment important à souligner.
Quand un enfant a peur et qu’il a l’impression d’être complètement démuni, qu’il ne peut rien faire sans l’aide d’un adulte, on renforce — sans le vouloir — son sentiment d’impuissance. Et plus on se montre constamment disponible et protecteur, plus on envoie le message : “Tu ne peux pas y arriver tout seul.”
Du coup, la peur devient encore plus forte, parce que l’enfant se dit : “Et si mon parent n’est pas là ? Si je suis tout seul ?”. Là, c’est la panique assurée.
Alors que ce que tu viens de proposer — “Je suis en bas, si tu as besoin, tu peux venir” — ça envoie un tout autre message : “Je te fais confiance. Tu es capable de faire la différence entre une peur gênante et un vrai danger. Tu es capable de prendre une décision, et de demander de l’aide si vraiment tu en as besoin.”
Et ça, je trouve que c’est beaucoup plus valorisant que simplement protéger. Parce que ça aide l’enfant à reprendre du pouvoir sur ce qu’il vit, plutôt que de le maintenir dans la dépendance.
Marina — Oui, et ce que tu dis là, ça touche aussi à l’estime de soi et à la confiance en soi.
C’est quelque chose qu’on veut tous nourrir chez nos enfants.
Quand la fierté d’avoir affronté une « vraie » peur aide nos enfants
Marina — Et cette posture — qui consiste à ne pas éliminer la peur à tout prix, mais à aider l’enfant à y faire face — c’est une vraie façon de l’y aider. C’est peut-être moins direct que de lui dire “N’aie pas peur, tout va bien”, ce qui peut le rassurer sur le moment, mais la peur, souvent, revient le lendemain.
Alors que là, en profondeur, l’enfant vit une autre expérience. Ce ne sera peut-être pas agréable pour lui de rester seul dans sa chambre… mais c’est aussi une des choses qu’on doit parfois accepter, en tant que parent : mettre notre enfant dans une situation un peu inconfortable pour lui permettre de grandir.
Et le lendemain, il pourra se dire : “Waouh, je me suis endormi tout seul. J’ai réussi. Même si ça m’a pris du temps, j’ai tenu bon.”
Et là, c’est lui qui est acteur de sa victoire. Il a traversé la peur, et il en sort plus fort.
C’est exactement ça que je dis souvent aux parents quand on travaille sur des troubles anxieux : l’objectif, c’est de rendre l’enfant plus fort, parce qu’il aura vaincu sa peur lui-même.
Sandrine — Oui, ça me parle beaucoup, et ça fait aussi écho à ce que j’appelle la notion de fierté.
Je dis souvent aux gens : “On est fier de soi quand on a réussi à faire quelque chose de difficile.”
Et c’est là où minimiser la peur peut poser problème. Quand on dit : “Allez, c’est juste une petite bête, elle ne va pas manger la grosse !”, ou d’autres phrases du même style, on essaie de réduire la peur, de la rendre insignifiante. Mais souvent… ça ne marche pas très bien.
Et même si l’enfant parvient à surmonter cette peur — parfois en serrant les dents — eh bien il n’en retire pas grand-chose. Parce que dans sa tête, il a juste vaincu une peur ridicule, une “petite peur de merde”, pardon pour le terme. Et donc, il n’est pas vraiment fier de lui.
Alors que si on reconnaît la peur, qu’on la regarde avec lui, et qu’il la dépasse, là, il y a de la fierté.
Parce qu’il sait qu’il a fait quelque chose de vraiment courageux.
Marina — Mais oui, c’est tout à fait ça : il perd la gloire ! C’est exactement le mot.
On dit souvent que le courage, ce n’est pas de ne pas avoir peur, c’est d’avancer malgré la peur, et de réussir à la traverser. Et c’est vrai que si la peur est présentée comme minuscule ou ridicule, alors même s’il la surmonte, il y a moins de fierté, moins de sentiment de victoire.
Donc parfois — sans aller jusqu’à renforcer la peur bien sûr — on peut simplement dire : “Moi je n’ai pas peur, mais je comprends que toi, tu aies peur. Et je vois que c’est difficile pour toi.”
Et rien que ça, c’est un message très valorisant. Parce qu’on reconnaît l’effort que l’enfant fait, et ça lui permet de se sentir fier de lui quand il y arrive.
Préciser la peur pour mieux l’apprivoiser
Sandrine — Oui, c’est tout à fait vrai. Et d’autant plus que, comme tu le dis, minimiser la peur, ça fonctionne rarement vraiment. Alors bien sûr, on peut toujours essayer un peu, voir si ça passe…
Mais dès qu’on voit que ça ne marche pas, mieux vaut changer de stratégie, parce que sinon, on risque de s’enfermer dans quelque chose qui ne fait que renforcer l’inconfort.
Et puis, minimiser, ça peut aussi prendre la forme de rationaliser. Et c’est vrai que, parfois, avec les plus petits, on peut leur dire : “Bon, au pire, qu’est-ce qui va se passer ?”. Et pour de petites peurs, ça peut fonctionner. Ça leur permet de relativiser, de se projeter un peu, et parfois, ça suffit à apaiser.
Mais comme tu allais le dire aussi, il y a des moments où même ça, ce n’est pas suffisant…
Marina — Oui, ce n’est pas du tout la même chose. Tu n’es pas en train de dire “N’aie pas peur, c’est rien, ça ne compte pas.”. Tu dis plutôt : “Au pire, qu’est-ce qui pourrait se passer ?”. Et ça, c’est déjà un autre type de réflexion.
Je pense que c’est un réflexe qui peut vraiment aider. En tout cas, moi, je l’utilise souvent pour moi-même : quand j’ai peur de quelque chose, je me demande simplement : “C’est quoi le pire qui pourrait arriver ?”. Et je n’ai même pas besoin d’en faire des tonnes ou d’imaginer tous les scénarios. Juste poser la question, ça suffit souvent à poser un cadre, à calmer un peu.
Même dans des situations toutes simples. Par exemple : “Je suis en retard. Ok… au pire, je suis en retard, est-ce que j’ai vraiment besoin de courir comme une dératée ? » Pas forcément.
Sandrine — Ça me fait penser à une situation que j’ai accompagnée, avec une jeune fille en CM2.
Elle commençait à penser à son entrée en 6e, et elle était terrorisée par l’idée des deux jours d’intégration organisés par le collège.
Ce n’était pas un vrai week-end, mais deux journées avec une nuit en dortoirs… Et pour elle, c’était l’angoisse totale. Sa maman était complètement démunie. Elle avait essayé de la rassurer : “Mais enfin, ce n’est pas si grave, tu vas voir, ça va être génial !”
Mais évidemment, ça ne marchait pas.
Marina — Dans ce genre de situation, l’enfant peut très vite se dire : “Mais qu’est-ce qu’elle en sait, elle ? Elle n’est pas à ma place !”, “Elle dit que ça va être génial… mais elle n’en sait rien !”
Et au lieu de calmer la peur, ça l’alimente. L’enfant se met à penser encore plus fort : “Elle ne se rend pas compte que ça, et puis ça, et puis encore ça…”. Et donc la peur augmente au lieu de diminuer.
Sandrine — C’est vraiment ça, oui : l’intention est de rassurer, mais le résultat, c’est que la peur prend encore plus de place. Avec cette petite fille, je lui ai simplement demandé : “Qu’est-ce qui te fait peur, exactement ? Qu’est-ce qui t’inquiète dans ce séjour ?”
Et là, elle a pu mettre des mots très précis. Ce n’était pas juste “j’ai peur de partir”, c’était : “Et si, dans le dortoir, il se passe quelque chose de gênant ? Imaginons qu’une fille vomisse dans la chambre, et qu’après, on soit étiquetées comme les filles de la chambre bizarre pour toute l’année.”
Sur le moment, moi, je me suis dit “Bon, ce n’est pas si grave”. Mais pour elle, c’était énorme, parce que ce qui était en jeu, c’était la réputation. C’était la peur d’être jugée, d’avoir une mauvaise image qui lui colle à la peau.
Et c’est là que préciser la peur devient très utile. Je lui ai dit : “Ok, mais qui va te juger ? Tout le monde ? Est-ce qu’il y a des gens dont tu n’as rien à faire de l’avis ? Et est-ce qu’il y a des gens dont l’avis, pour toi, compte vraiment beaucoup ?”
Je le dis souvent : Une peur floue est toujours plus effrayante qu’une peur concrète. Et de manière générale, moins on sait, plus on s’angoisse.
Je lui ai demandé de préciser QUI exactement allait la juger. Et là, en allant au bout de cette peur, elle m’a dit : “Mais en fait, les gens qui comptent vraiment pour moi… eux, ils ne me jugeraient jamais comme ça.”. Et pour les autres : “S’ils pensent des trucs idiots, tant pis, je n’y peux rien. Et au pire, j’essaierai de parler à certains qui sont un peu moins bêtes et pourraient comprendre.”
Et voilà. La peur s’est dégonflée toute seule, simplement parce qu’elle avait été regardée en face, avec précision.
Marina — C’est vrai que le simple fait d’aller regarder une peur de plus près, très souvent, réduit déjà son ampleur. Parce que bien souvent, les peurs sont liées à des amalgames, à des généralisations.
Par exemple : “J’ai peur des chiens.”. Mais de tous les chiens ? Alors l’une des premières choses que je propose, c’est d’aller s’informer : quels chiens sont potentiellement dangereux ? Quels sont les signaux à observer pour savoir si un chien est stressé, s’il veut jouer, s’il vaut mieux s’en éloigner ?
Le simple fait d’avoir plus de connaissances permet déjà, en général, de faire baisser le niveau de peur.
Et en plus, c’est une occasion d’observer les chiens : de les regarder vraiment, plutôt que de détourner les yeux ou de changer de trottoir. Parce que quand on a peur, c’est souvent ce qu’on fait : on évite de regarder.
Prenons les personnes qui ont peur des araignées : elles détournent tout de suite le regard, voire ferment les yeux. Alors que, j’ai envie de dire, plus elles prendraient le temps de les observer, moins elles en auraient peur, avec le temps.
Sandrine — Oui, alors… il faut avoir envie de vaincre sa peur pour pouvoir regarder une araignée, ça, c’est sûr !
Et face aux grandes peurs existentielles ? (Comme la peur de la mort)
Sandrine — Mais c’est vrai que jusqu’ici, on a beaucoup parlé des peurs qu’on peut concrétiser, des peurs où on peut anticiper les conséquences, imaginer des scénarios, etc.
Et puis, il y a d’autres types de peurs, qui sont beaucoup plus floues, ou en tout cas, plus existentielles, plus difficiles à maîtriser. Je pense, par exemple, à la peur de la mort, qui est assez fréquente chez les enfants, et parfois même très envahissante.
Alors, qu’est-ce qu’on fait avec ce genre de peur ? Qu’est-ce qu’on fait de différent, quand il n’y a pas vraiment de solution concrète ou de scénario rassurant à proposer ?
Marina — Alors finalement, ce n’est pas si différent dans l’approche, même si on ne travaille pas tout à fait au même niveau.
Je pense à une petite fille que j’ai accompagnée. Elle avait peur que sa maman meure.
Il y avait eu un événement dans sa classe, peut-être une autre enfant confrontée à la maladie ou au deuil, ou une discussion en classe… Bref, quelque chose avait activé cette peur.
Et la réaction spontanée de la maman, c’était de dire : “Mais non, je ne vais pas mourir.”. Le problème, c’est que ce n’est pas vrai. On va tous mourir, un jour.
Donc, comme toujours, la première étape, c’est de pouvoir entendre la peur, l’accueillir. Mais contrairement à une peur plus concrète — comme celle des chiens, par exemple — on ne peut pas vraiment se protéger de la mort. Alors ce qu’on va faire, c’est accompagner l’enfant à affronter cette peur-là, imaginer ce qu’il redoute au maximum.
Je propose souvent aux parents de faire ce travail eux-mêmes avec l’enfant. Mais parfois, ce n’est pas possible : la peur touche aussi les parents, ça les renvoie à leurs propres angoisses.
J’ai en tête un père que j’avais rencontré en séance. Son fils avait peur que sa maman meure. Je lui ai demandé s’il pouvait accompagner son fils dans cette peur. Mais même le papa était trop effrayé lui-même à l’idée de la mort de sa femme. Donc dans ce cas, il vaut mieux le faire en séance.
Et c’est vrai : c’est terrible, c’est une idée horrible, inacceptable, surtout pour un enfant de 6 ou 7 ans.
Mais à cet âge-là, les enfants prennent conscience que ça peut arriver. Et leur dire “non, ça n’arrivera pas”, c’est parfois encore plus anxiogène que les histoires de monstres, parce qu’ils sentent bien que ce n’est pas vrai.
Alors bien sûr, on peut rassurer dans un premier temps : “Je suis en bonne santé, tout va bien, la maman de Thomas était malade, ici ce n’est pas le cas.” Mais si la peur revient souvent, surtout le soir — ce moment où les angoisses refont surface — alors il faut aller plus loin.
Et c’est là que je dis à l’enfant : “OK. Imaginons que ce que tu redoutes arrive. Imaginons que ta maman meure. Qu’est-ce qui se passerait ?”. Et on déroule ensemble cette histoire difficile.
On l’accompagne pas à pas, en lui disant : “Tu pleurerais, bien sûr, peut-être pendant longtemps. Tu serais avec ton papa, ton frère, ta sœur. Qu’est-ce qui se passerait ensuite ?”
Pour ma part je pose des questions très concrètes : “Tu pleurerais combien de jours, à ton avis ?”. Et parfois, ils me répondent des choses très étonnantes, comme “une semaine”. Ce n’est pas réaliste, bien sûr, mais ce n’est pas ça l’important. L’important, c’est qu’ils mettent des images, des repères, sur ce scénario qu’ils fuient.
Je les aide à imaginer la suite : “Et après, tu retournerais à l’école ? Pas tout de suite ? Dans combien de temps ? Tu mangerais avec qui ? Tu dormirais où ?”. On reconstruit un quotidien.
Et c’est ça qui les apaise : ne plus être face au flou, mais avoir un fil, une histoire, une forme de continuité, même si elle est imaginaire.
Comme tu le disais tout à l’heure, il y a une forme de reprise de contrôle. Ou au moins une illusion de contrôle, mais ça suffit souvent à faire redescendre l’anxiété.
Alors oui, ça reste un sujet difficile, un risque désagréable à envisager, mais c’est souvent moins violent que le silence ou le déni, et ça permet à l’enfant de vivre avec cette peur, plutôt que de la fuir en boucle.
Sandrine — Alors là-dessus, je ne sais pas quel est ton point de vue, mais je pense effectivement que les parents peuvent accompagner ce type de peur. Mais en même temps, ce n’est pas une peur qu’on peut laisser l’enfant affronter seul.
Ce n’est pas le genre de peur où on va lui dire : “Réfléchis un peu, imagine ce qui se passerait…” en le laissant faire tout seul dans sa tête. C’est important que l’enfant soit accompagné, soit par un professionnel, soit par un parent qui a bien saisi la logique de cette démarche.
Parce que ce sont des peurs très fortes, parfois profondément bouleversantes, et ça nécessite une vraie présence adulte, une forme de contenance, pour que l’enfant puisse traverser ça sans être submergé.
Marina — Oui, c’est ça, c’est très important. Ce qui compte vraiment, c’est de ne pas rester bloqué au cœur de la peur.
Si l’enfant fait ce travail tout seul, ou même si c’est un parent qui l’accompagne mais qu’il se retrouve à dire : “Et alors tu vas pleurer tout le temps ?” et que l’enfant répond : “Oui, tout le temps…” mais qu’ensuite, le parent ne sait plus quoi dire, ou qu’il est lui-même trop touché, trop bouleversé pour continuer, là, on risque de s’arrêter en plein milieu, au moment où la peur est la plus forte.
Et c’est là que c’est essentiel d’aller jusqu’au bout du scénario. D’amener l’enfant jusqu’au moment où, oui, la vie continue, ou plutôt reprend : “Tu vas pleurer, oui. Et puis, un jour, tu vas peut-être rigoler à nouveau avec ta sœur. Il n’y aura plus maman, c’est vrai, mais la vie va reprendre.”
Et parfois, j’utilise aussi les croyances de l’enfant. Je lui demande : “Tu crois que maman, elle serait où ?”. Et s’il me dit : “Au ciel”, alors je peux dire : “Peut-être qu’elle nous regarde de là-haut.”
On redonne une place symbolique, et en même temps, on revient dans le concret : les repas, l’école, les jeux, les liens avec les autres. Encore une fois, l’idée, c’est vraiment d’amener l’enfant jusqu’au moment où la vie continue. C’est ça, pour moi, le cœur du travail.
Sandrine — Ça me fait penser à deux situations personnelles, justement en lien avec cette peur de la mort.
La première, j’en avais parlé dans cet article il y a quelques années. C’était avec ma fille, qui devait avoir environ sept ans à l’époque. Un soir, elle s’était endormie normalement, puis une heure plus tard, elle était redescendue en pleurs, complètement bouleversée.
Elle m’a dit : “J’ai fait un cauchemar… J’ai rêvé que je n’avais plus ni papa ni maman, que vous étiez morts tous les deux.” Elle était vraiment très mal.
Et j’avais saisi cette occasion pour l’accompagner dans sa peur. Je lui ai dit : “Oui, ce serait vraiment horrible. Mais dis-moi, si ça arrivait, est-ce que tu sais ce qu’il se passerait ? Comment tu imagines les choses ?”. Et le fait de projeter concrètement un “après”, même imaginaire, l’a vraiment aidée à traverser cette angoisse.
Et puis j’ai une autre anecdote, beaucoup plus drôle, cette fois ! Mes enfants étaient tout petits — trois et cinq ans, je crois. On était en voiture, on écoutait la radio, et le journaliste évoque un accident dans lequel un couple est décédé, dont la maman enceinte. C’était affreux, bien sûr, et ce jour-là, mes enfants ont compris que les deux parents pouvaient mourir en même temps.
Et à table, le soir, le sujet est revenu. Ils ont commencé à se poser la question : “Mais… comment ça se passe pour les enfants, si les deux parents meurent en même temps ?”. Alors je leur ai demandé :
“Et vous, qu’est-ce que vous feriez si papa et maman mouraient tous les deux en même temps ?”
Et leur préoccupation principale, c’était : “Mais … comment on va faire pour manger ?”
J’ai adoré. Parce que, vraiment, les enfants ont parfois des réactions tellement directes, et en même temps très logiques. Et ils ont trouvé une solution !
À l’époque, leur baby-sitter, c’était la fille de nos voisins, une famille turque. Chaque fois qu’elle les gardait, elle les emmenait manger chez sa mère plutôt que de les faire manger à la maison, et ils adoraient ça.
Alors ils se sont dit, tout naturellement : “Ben, on ira chez Alimé, la voisine nous donnera à manger !”
Marina — Il y avait une solution, en plus, qui était bonne ! Je ne sais pas comment tu cuisines… mais visiblement, ils avaient trouvé mieux ailleurs !
Et c’est vrai qu’on est souvent surpris par le côté très pragmatique des enfants. C’est pour ça que, quand on fait ce travail avec eux, il faut vraiment faire attention à ne pas induire des choses à leur place.
Ce que tu racontes est intéressant, parce qu’on pourrait se dire, en tant qu’adulte : “Oui, mais c’est terrible, les enfants ne savent même pas où ils vont aller vivre…”. Alors que ce n’est pas forcément leur souci, à ce moment-là. Ça ne sert à rien de rajouter nos peurs d’adultes à celles de l’enfant. Ils penseront à ces questions-là le moment venu … si ça devait arriver. Peut-être trois ans plus tard, qui sait ?
Et c’est une chose vraiment importante à rappeler : si un parent veut accompagner son enfant dans l’exploration d’une peur — que ce soit la peur des monstres ou celle de la mort — il ne s’agit pas de lui dire : “Tu as peur que le monstre te mange ?”.
Parce que peut-être que l’enfant n’y avait pas du tout pensé, et là on lui rajoute une peur de plus.
L’idée, c’est plutôt de rester dans son univers à lui, et de lui poser des questions ouvertes : “Toi, de quoi tu as peur ? Comment tu imagines que ça se passerait ? Et qu’est-ce que tu ferais ?”
C’est sa vision qui compte. Pas la nôtre.
Comment savoir si on doit consulter pour une peur de notre enfant qui dure ?
Sandrine — Bon, je pense qu’on a déjà bien couvert la question de l’accompagnement des peurs qui persistent, même après des tentatives tout à fait logiques de rassurer, de protéger, d’écouter…
Mais j’avais encore une question que je voulais te poser parce que je pense que c’est une vraie préoccupation pour beaucoup de parents. À quel moment on se dit, en tant que parent : “Là, je suis au bout de ce que je peux faire. J’ai essayé, mais ça ne suffit pas. Peut-être qu’il faudrait que mon enfant voie quelqu’un d’extérieur, un professionnel, parce que je n’arrive pas à l’aider.”
Est-ce qu’il y a des signes ou des indicateurs qui peuvent alerter sur le fait que le soutien parental ne suffit plus ?
Marina : — En fait, je dirais que le bon moment pour consulter, c’est quand on a déjà essayé plusieurs choses, qu’on a laissé un peu de temps, et qu’on constate que ça ne bouge pas.
Tu l’as très bien dit dans l’introduction : il y a des peurs qui disparaissent d’elles-mêmes. Et parfois, c’est justement en intervenant trop tôt ou trop fort qu’on finit par les renforcer, presque malgré nous.
Je pense à une maman qui m’a appelée juste après la rentrée scolaire. Sa petite fille — elle avait cinq ans — se mettait à pleurer chaque fois que c’était la maman qui la déposait à l’école ou à une activité.
Elle s’accrochait à elle, disait qu’elle avait peur… alors que quand c’était le papa ou la voisine, tout se passait bien.
Je lui ai dit : “C’est sûrement juste une phase. Elle doit retrouver le rythme, reprendre ses marques avec les séparations.”. Et je l’ai encouragée à ne pas lâcher, à ne pas annuler les activités ou à reprendre sa fille à la moindre larme. Mais surtout, à transmettre de la confiance : lui dire “Je te laisse, tout va bien se passer” avec un ton ferme et serein.
Elle l’a fait, et en trois fois, le problème était réglé. Alors que si elle avait cédé ou renforcé le message d’inquiétude, on aurait peut-être construit une peur durable, là où ce n’était qu’un passage.
Donc c’est important de se rappeler que la peur fait partie du développement. Un enfant qui parle de la mort une fois, deux fois, ce n’est pas inquiétant. Il prend conscience que le monde n’est pas entièrement sécurisé, et c’est aussi ça, grandir.
Maintenant, quand on a essayé, qu’on sent qu’on s’épuise, que ça prend beaucoup d’énergie sans résultats, alors oui, c’est le moment de consulter.
Mais pour moi, la première consultation, elle peut (et souvent, elle doit) se faire avec le parent seul.
Quand on m’appelle, la consigne est de prendre d’abord un rendez-vous pour le parent, pas forcément pour l’enfant.
Parce que très souvent, on peut faire évoluer les choses en travaillant uniquement avec le parent. C’est moins stigmatisant pour l’enfant, on évite de le “problématiser”, et on rend le parent acteur. On dit souvent que les parents sont les co-thérapeutes de leurs enfants.
Et c’est d’autant plus vrai avec les jeunes enfants : un petit de 4 ou 5 ans, il voit un thérapeute 45 minutes tous les quinze jours … et deux minutes après la séance, il est reparti dans autre chose.
Alors qu’un parent, lui, reste dans le quotidien, il peut mettre en place ce qu’on lui propose, ajuster, observer, et ça peut vraiment débloquer des peurs chez l’enfant très rapidement.
Donc oui, consulter, c’est parfois nécessaire — mais commencer par le parent, ce n’est pas parce qu’il a un problème, c’est parce que c’est lui qui peut être une grande partie de la solution.
Sandrine : — Oui, là-dessus, je te rejoins complètement. C’est aussi l’approche qu’on partage toutes les deux, et qu’on appelle la thérapie indirecte.
L’idée, ce n’est pas que les parents ont un problème, mais qu’on peut les aider à interagir plus efficacement avec leur enfant, à poser des actes qui vont vraiment avoir un impact différent.
Et je suis totalement d’accord : avec les jeunes enfants, c’est beaucoup plus efficace de travailler avec les parents, parce que ce sont eux qui sont au quotidien dans les interactions. Le parent, lui, peut revenir sur l’expérience, répéter, ancrer ce qui a été proposé, et c’est ça qui change les choses.
Et puis, bien sûr, quand les enfants grandissent, certains deviennent demandeurs, moteurs, expriment eux-mêmes leur envie de parler à quelqu’un. Et là, on peut tout à fait les recevoir en direct, parce que l’alliance se fait avec eux, et qu’ils sont capables de s’impliquer activement dans l’accompagnement.
Marina : — Oui, oui, il m’arrive régulièrement de recevoir des enfants, bien sûr. Mais je trouve que, dans beaucoup de cas, travailler d’abord avec le parent suffit.
Et si on peut alléger l’intervention au maximum, éviter d’être trop intrusif dans la vie familiale, c’est souvent plus intéressant. D’autant plus que, par l’intermédiaire du parent, on peut parfois faire un travail encore plus efficace, plus intégré au quotidien.
Alors évidemment, il y a des situations où voir l’enfant devient nécessaire, et c’est tout à fait justifié. Mais je te rejoins totalement sur le côté dépathologisant de l’approche indirecte.
Quand on envoie un enfant voir un thérapeute, il peut facilement entendre un message du type : “C’est toi le problème. Tu dysfonctionnes.” Et ça, on sous-estime parfois l’impact que ça peut avoir.
Bien sûr, on peut lui expliquer que c’est bien de demander de l’aide, que ça fait partie de la vie, etc.
Mais malgré tout, certains enfants l’intègrent comme une blessure, comme quelque chose qui abîme l’image qu’ils ont d’eux-mêmes.
Alors que, justement, on a d’autres manières de faire. Des manières plus douces, plus respectueuses, qui ne laissent pas de traces inutiles, et qui permettent quand même d’accompagner la peur efficacement.
Sandrine : — Oui, et moi, ce que j’explique aussi très souvent aux parents, c’est que quand un problème dure, quand on en arrive à consulter quelqu’un de l’extérieur, c’est rarement pour une difficulté passagère. En général, ça fait déjà un moment que ça dure, que ça crée des tensions, de l’inquiétude, des conflits à la maison.
Et donc, l’enfant a déjà beaucoup entendu parler de ce qui ne va pas chez lui. Que ce soit parce qu’il n’arrive pas à gérer sa peur, qu’il ne sait pas la surmonter, parce qu’il se comporte mal, qu’il répond, qu’il est trop sensible, trop ci, pas assez ça…
Et moi, ce que je dis souvent, c’est que pédagogiquement, pour l’enfant, ce n’est pas forcément très utile qu’il entende une fois de plus, devant un tiers, tout ce qui “dysfonctionne” chez lui. C’est pas super sympa, en fait. Ce n’est pas très soutenant pour lui, et ça nourrit rarement l’estime de soi.
C’est pour ça que travailler d’abord avec le parent, ça peut éviter d’enfoncer l’enfant dans cette image problématique de lui-même. Et ça permet souvent de changer la dynamique en douceur, sans avoir à poser d’étiquette.
Marina : — Ah mais ça, c’est clair : je ne prends jamais un enfant en première séance avec les parents. Jamais. Si je dois voir l’enfant, je le vois seul. Mais je vois toujours d’abord les parents, sans l’enfant.
Parfois, malgré ce que j’ai précisé au téléphone, les parents arrivent quand même avec l’enfant dans la salle d’attente. Et dans ces cas-là, je suis très claire : “S’il ne peut pas rester seul, alors on reporte le rendez-vous.” Je l’ai déjà fait, et même si je n’ai pas envie de le faire souvent, je reste ferme là-dessus.
Parce que je veux bien voir un enfant, mais seulement après avoir vu les parents seuls. Et comme toi, je trouve ça vraiment toxique pour l’enfant d’être témoin d’un discours dans lequel on va vouloir tout déballer à la psy, pour donner le plus d’infos possibles. L’enfant entend tout, il encaisse, même s’il ne dit rien.
Et inversement, parfois, les parents n’osent pas parler franchement, pour ne pas blesser ou inquiéter l’enfant. Résultat : on n’a pas toutes les infos non plus.
Donc dans les deux cas, quelqu’un est perdant. Alors que si on voit d’abord les parents seuls, on peut parler entre adultes, dire les choses comme elles viennent, sans filtre. Et surtout, sans abîmer l’enfant.
C’est quelque chose que je défends vraiment, et qu’on enseigne clairement dans nos formations :
Ne pas recevoir l’enfant avec les parents. Je sais que certains le font encore, mais pour moi, c’est une erreur.
Parce qu’on le voit bien : ce sont souvent des enfants qui ont déjà entendu beaucoup de choses sur eux, parfois des choses très maladroites. Et là, en plus, on va chercher des explications qui remontent à la naissance, aux ressemblances familiales, “il est comme le grand-père qui était comme ci, comme ça…”. Franchement, ils peuvent s’en passer.
Sandrine : — Je me permets juste de revenir sur ce que je disais, parce qu’il y a un point important à ne pas négliger : parfois, les enfants disent “oui” à un accompagnement juste pour avoir la paix.
Je pense à une situation que j’ai accompagnée, avec une maman qui me parlait de son fils, un jeune garçon qui avait beaucoup de mal à gérer ses émotions, en particulier la colère. Alors ce n’était pas une peur, mais ça pourrait faire l’objet d’un autre épisode — même si j’ai déjà pas mal parlé de la colère sur le podcast, mais bref.
Je lui avais expliqué que, normalement, je voyais d’abord les parents seuls, sauf si l’enfant demandait explicitement à être aidé : s’il disait lui-même “oui, j’ai un problème, je veux qu’on m’aide”.
Et elle me rappelle en me disant : “C’est bon, il est d’accord, il reconnait qu’il a un problème, il veut venir.”
Mais le jour du rendez-vous… je vois bien à l’attitude du garçon que quelque chose cloche. Il est affalé sur son fauteuil, répond à moitié à mes questions, visiblement pas motivé.
Alors au bout d’un moment, je me tourne vers lui et je lui demande : “Dis-moi… ta maman m’a dit que tu avais dit que tu avais un problème et que tu voulais de l’aide. Tu l’as dit parce que tu le penses vraiment ? Ou tu l’as dit pour qu’elle te lâche un peu les baskets ?”
Et là, il me regarde et dit : “Pour qu’elle me lâche les baskets.”
Et tout de suite, la maman, qui était assise à côté, réagit : “Bon… OK. On le remet dans la salle d’attente, et on va discuter toutes les deux.”
Marina — Mais oui, bien sûr ! Et tu vois, j’ai eu un peu la même situation, mais avec un ado, cette fois… qui était… payé pour venir en thérapie !
Les parents non seulement paient la thérapie, mais paient aussi le jeune pour qu’il accepte de venir.
Alors parfois, ça peut être un moyen de démarrer quelque chose, pourquoi pas. Mais souvent, ce que ça montre, c’est à quel point les parents sont démunis, qu’ils ne savent plus quoi faire, qu’ils sont désespérés de trouver une solution. Et ça, je le comprends tout à fait, c’est vraiment légitime.
Mais malheureusement, dans notre approche — et tu l’as très bien dit — ce sont les expériences qu’on propose qui font bouger les choses. Et pour que ces expériences aient un effet, il faut un minimum d’engagement de la part du jeune.
Or, quand l’ado n’est pas du tout demandeur, quand il est juste là parce qu’il faut venir ou parce qu’il est payé … eh bien, on n’a pas le bon levier. Dans ce cas, le jeune n’est pas même pas motivé du tout pour que les choses changent : plus la thérapie dure, plus il gagne d’argent !!!
Donc très souvent, on avance beaucoup mieux en travaillant avec les parents, surtout au début.
En conclusion : face à la peur, faire confiance à l’enfant, à ses compétences de parent … et au temps
Sandrine : — Bon, eh bien, on a abordé pas mal de choses autour de la peur… et pas seulement la peur, d’ailleurs ! On a bien élargi le sujet.
Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter ? Ou est-ce que tu aurais envie de nous laisser une petite conclusion, un mot de la fin de ton côté, pour clore cet épisode ?
Marina : — Pour moi, la conclusion, ce serait de rappeler quelque chose de simple mais essentiel :
Faites d’abord avec votre cœur. Faites avec votre instinct, vos tripes. Et dans beaucoup de situations, ça suffit déjà à faire bouger les choses.
C’est quand ça coince, quand ça dure, quand on sent que malgré tout, ça ne passe pas, qu’on peut envisager de se faire aider.
Mais il faut aussi faire confiance au temps. Les enfants, ça évolue, ça change, ça grandit. Et ça, c’est une ressource précieuse qu’ils ont … et que nous, adultes, on a parfois un peu moins !
Alors évidemment, je ne dis pas qu’il faut laisser un enfant souffrir de peur pendant des mois, mais parfois, les choses passent plus vite qu’on ne le pense. Et il arrive que trop d’interventions, trop d’insistance, finissent par renforcer la peur plutôt que l’apaiser.
Voilà, ce n’est pas un point en plus, c’est plutôt une façon de résumer tout ce qu’on a dit.
Sandrine — Un grand merci à toi, Marina, pour cet échange riche et plein de nuances.
Et … peut-être à très bientôt pour un prochain épisode !
Des ressources pour savoir comment accompagner les peurs des enfants
J’ai écrit pas mal d’articles sur la peur. En voici quelques-uns qui pourraient vous aider :
- un article de Marina sur la peur du dodo ou comment transformer la peur en courage
- « Maman j’ai peur de vomir » ou comment aider son enfant à faire face à la peur de vomir
- Mon enfant a peur des insectes
- La peur signal d’alarme, pour mieux comprendre la peur
- « Maman j’ai rêvé que je n’avais plus ni papa ni maman »
- … et il y en a d’autres !
Quelques livres :
- « je n’ai plus peur de mes peurs » d’Emmanuelle Piquet et Amélie Graux, un livre pour enfant
- « Peurs, paniques, phobies » de Giorgio Nardone, pas spécifique aux enfants mais qui permet de comprendre les pièges de l’évitement et de l’aide
Pour finir …
Vous pensez avoir besoin d’un accompagnement ? Découvrez en plus sur mes accompagnements. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous directement en ligne :
Vous pouvez vous abonner à ma newsletter pour avoir les informations des nouveaux articles et aussi les infos sur les prochaines conférences :
Ce contenu vous a été utile ? Vous pouvez me le faire savoir en me faisant un don ponctuel ou récurrent. Ces dons me permettent de libérer du temps pour produire plus de contenu gratuit et accessible à tous.
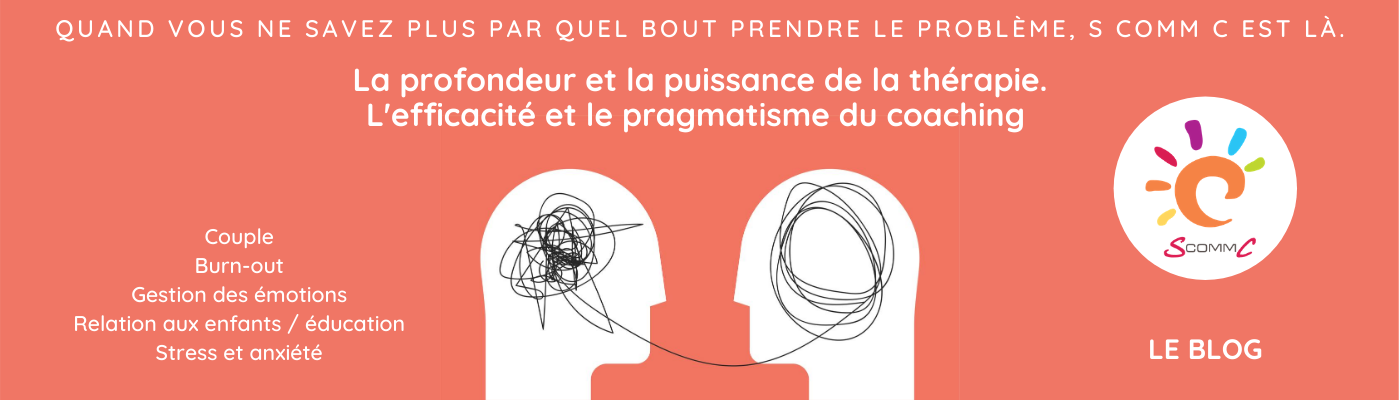


Ping :Mon enfant pleure encore à la séparation un mois après la rentrée : que faire ? - S Comm C, le blog