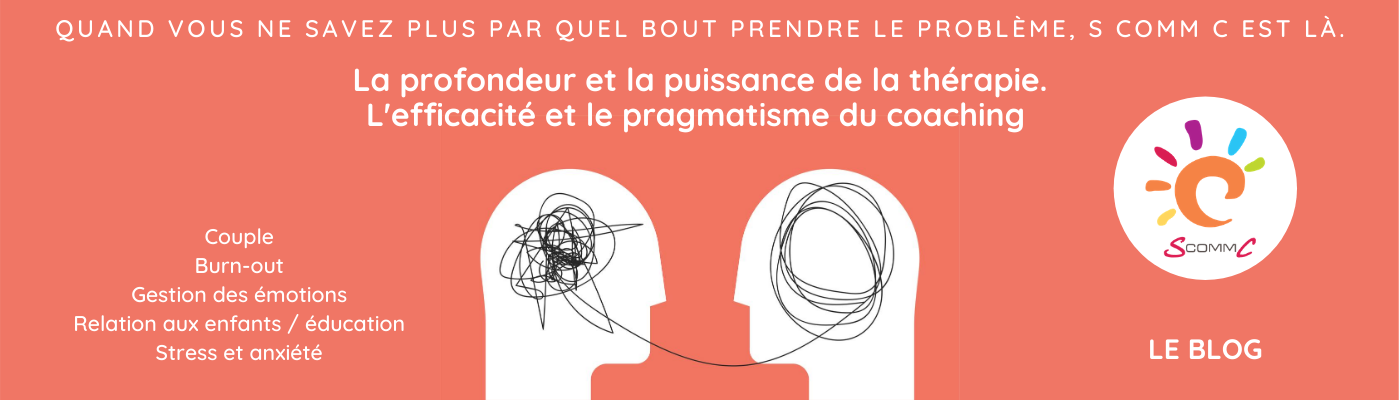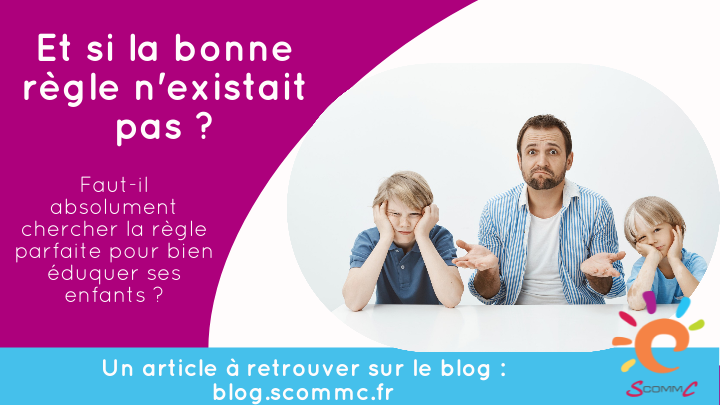Parentalité : et si la bonne règle n’existait pas ?
Faut-il absolument chercher la règle parfaite pour bien éduquer ses enfants ? Une réflexion sur l’autorité, la coopération et la parentalité qui s’ajuste plutôt qu’elle ne s’impose.
Si vous êtes parent et que vous avez déjà tapé dans Google un truc du genre :
- « Quelle est l’heure de coucher idéale selon l’âge ? »
- « Combien de temps d’écran pour un enfant de 7 ans ? »
- « À quelle heure coucher mon enfant ? »
Alors, cet article est pour vous !
On a tous fait ça, moi la première (il y a longtemps, parce que les enfants sont grands ! mais je l’ai fait)
Et en fait, on veut bien faire, on veut le bon cadre, la bonne méthode, la règle qui va nous rassurer, celle qui aussi peut-être va éviter les conflits, les crises, les hurlements à 21h30 parce que la brosse à dents est trop mouillée. Et surtout, celle qui va nous faire sentir qu’on fait ce qu’il faut, qu’on est bien dans notre rôle de parent.
Mais est-ce qu’elle existe, cette fameuse bonne règle ?
Et est-ce qu’il n’y aurait pas en prime quelques effets secondaires pas très sympathiques à chercher la bonne règle ?
C’est ce qu’on va explorer aujourd’hui dans ce nouvel article.

EP.26 Et si la bonne règle n'existait pas ? – Du côté des parents !
Tous les parents cherchent la bonne règle
Donc aujourd’hui, j’ai eu envie de vous parler d’une question qui revient sans arrêt dans mes accompagnements, dans mes conférences, dans les messages que je reçois sur les réseaux sociaux, dans les questions qui me sont posées par mail.
Une question qui se décline sous mille formes, mais qui revient un peu toujours au même au fond :
Quelle est la bonne règle à poser ?
A quelle heure faut-il coucher son enfant ? Est-ce qu’il faut interdire les écrans ? Si on les limite, combien de temps ? Qu’est-ce que vous recommandez comme durée par jour ? Est-ce qu’il faut imposer ceci ou cela ?
Et souvent, il y a aussi une question, pas seulement sur la règle, mais sur comment, c’est quoi la bonne façon de faire respecter la règle.
Alors – bien que je sois savoyarde et pas normande – j’ai quand même envie de faire une réponse de normande à chaque fois et de dire : « ben, ça dépend« .
En réalité, ceux qui me connaissent le savent, j’aime bien être sûre que je réponds à la bonne question, quand je réponds à une question.
Et ce que j’entends, moi, derrière ces questions, c’est plusieurs choses : d’abord, il y a une envie de bien faire pour l’enfant, ce qui est plutôt chouette. Mais il y a aussi, donc, une demande de réassurance à deux niveaux :
- Est-ce que je fais bien ? C’est-à-dire, est-ce que je suis un bon parent ?
- Mais il y a aussi, comment être un bon parent sans s’épuiser, sans être brutal avec son enfant ?
Et ces demandes sont légitimes !
Et oui, c’est difficile d’être parent. Je l’ai déjà dit plein de fois : on doute, on se sent responsable de beaucoup. Et on EST responsable de beaucoup.
Et parfois, on aurait bien envie que quelqu’un nous dise « voilà, c’est comme ça qu’il faut faire, c’est la bonne façon, tu ne peux pas te tromper si tu fais comme ça ». CE serait tellement rassurant et apaisant.
Mais le problème, c’est que cette quête de la bonne règle, comme c’est une tentative d’apaiser notre anxiété parentale peut parfois devenir inefficace, voire contre-productive.
La carte n’est pas le territoire : pourquoi les règles toutes faites échouent
Et là, je vais faire appel à un concept qui est important en systémie (dans l’approche que je pratique dans mes accompagnements), c’est l’idée de la carte et du territoire.
La carte n’est pas le territoire.
La carte, c’est la théorie.
Ce sont les grands principes éducatifs, ce qu’on trouve dans les livres, dans les théories psychologiques, les recommandations grand public, ce que vous lisez dans les livres, ce que vous voyez sur Instagram, dans les médias, très souvent, ce que vous entendez dans les conférences.
(enfin, j’espère pas trop dans les miennes de conférences justement ! Mais venez assister à une de mes conférences pour me dire si c’est le cas ou pas).
Le territoire, c’est vous, votre enfant, la relation entre vous deux, votre contexte de vie, votre fatigue, vos ressources à un moment donné, votre histoire, vos valeurs, la dynamique de votre foyer, de votre famille.
Et la carte n’est jamais le territoire.
Déjà, une carte, c’est plat, alors que dans la vraie vie, sur le territoire, ça monte, ça descend, il y a des rochers, il y a des rivières, pas juste un trait bleu marqué au sol.
Et puis, en plus, la carte peut être fausse.
Et encore pire, vous pouvez utiliser la mauvaise carte.
Si vous voyagez en Italie avec la carte de France, vous allez avoir du mal à trouver votre chemin.
Et si vous êtes persuadés que c’est la carte qui a raison et que ça ne correspond pas au territoire sur lequel vous évoluez, vous allez commencer à remettre en cause ce que vous voyez, ce que vous ressentez, ce que vous vivez, et en faisant ça, vous vous envoyez implicitement le message « je ne peux pas me fier à mes propres perceptions », ce qui est quand même extrêmement angoissant.
Donc si l’objectif d’utiliser la carte c’était de vous rassurer sur le fait que vous n’alliez pas vous perdre, c’est raté.
En plus de ça, si vous appliquez une règle qui n’est pas adaptée à vous, à votre contexte, à votre enfant, ce qui va se produire, c’est que vous allez être en échec.
Une théorie fait rarement de bonnes règles
C’est comme si, l’image que je donnais : vous voyagez en Italie et vous avez une carte de France.
Et donc ça ne va pas marcher dans la relation avec votre enfant : il va y avoir beaucoup de heurts, beaucoup d’oppositions.
Déjà que quand la règle est adaptée, il y a de l’opposition !
Donc cette règle, elle est peut-être idéale – la carte de l’Italie, elle est parfaite pour voyager en Italie, mais pas pour voyager en France !
Et donc, là aussi, si vous partez du principe que c’est la carte qui a raison, vous allez dégrader votre sentiment d’efficacité en tant que parent.
Et vous allez être encore plus perdu, vous vous sentir totalement inefficace, vous allez chercher peut-être encore plus la carte, les précisions, le truc, et entretenir vos doutes.
Mais alors c’est quoi une bonne règle ?
Donc, clairement, une règle adaptée, c’est d’abord déjà une règle qui fait du sens pour vous.
Parce que c’est ce sens qui va vous permettre de tenir bon malgré l’opposition qui est assez inévitable.
J’en avais parlé dans un autre épisode, mais je me souviens d’une maman qui me disait « moi je veux qu’on me dise c’est quoi la bonne limite imposée à mes ados ». Et moi je lui avais demandé « comment est-ce que vous saurez que c’est la bonne ? » Elle me dit « ils la respecteront sans trop râler ».
Ben non, en fait, une règle n’est pas une règle qui est acceptée facilement et appliquée sans conflit.
Une règle par définition, ça vient contrarier quelque chose, ça vient poser une limite à une envie, à un comportement, et ça n’est pas agréable.
Donc ça va susciter des réactions désagréables chez l’enfant. Il va se plaindre, il va essayer de contourner, et c’est pas agréable à faire tenir non plus pour le parent.
C’est vrai, ça demande de l’énergie, ça demande de tenir bon.
En résumé : une règle n’est pas bonne parce qu’elle est appliquée sans résistance. Un des facteurs qui fait qu’elle est bonne, c’est quand on se sent à sa place quand on l’applique.
Et en plus, mon expérience me fait dire qu’une règle qui est un peu imposée de l’extérieur, qu’on n’assume pas vraiment pleinement, qu’on applique un peu sans conviction parce qu’elle ne fait pas vraiment du sens pour nous, l’enfant le sent. Il y a lors de gros risques qu’il s’oppose, qu’il résiste et cherche à contourner d’autant plus fort que ce n’est pas très clair pour nous.
Mais c’est pas mon point le plus important.
Une règle, ce n’est pas un ordre, c’est le résultat d’une négociation entre parents et enfants
Le point le plus important sur lequel je voulais attirer votre attention dans cet épisode, c’est qu’en réalité, une règle, c’est surtout le résultat d’une négociation non dite entre ce que le parent veut et ce que l’enfant accepte.
On peut rendre cette négociation explicite mais il est hyper important d’être conscient de ça :
Une règle, c’est le résultat d’une négociation non dite entre les parents et les enfants.
On a dans l’idée qu’un parent – un adulte – doit avoir le contrôle sur ses enfants.
Mais en réalité, on a bien peu de contrôle sur nos enfants. On n’en a que dans la mesure où ils acceptent de coopérer avec ce contrôle.
Je m’étais pris cette réalité en pleine face un jour où mes enfants étaient petits et où je faisais les courses avec eux. Ils étaient tous les deux dans le caddie, dans le supermarché. D’un coup, pour jouer, ils se sont mis à hurler comme des sirènes, mais vraiment très, très, très fort.
Ca m’a tellement fait mal aux oreilles que j’ai été obligée de m’éloigner du caddie quelques secondes !
Et ce jour-là, j’ai réalisé que je n’avais aucun moyen légal de faire taire mes enfants si eux ne décidaient pas de se taire.
Je pouvais bien tenter de les amadouer, de leur proposer des trucs sympas s’ils acceptaient de se taire.
Je pouvais bien les menacer, voire même mettre des menaces à exécution, les frapper, etc.
RIEN ne pouvait les réduire au silence s’ils n’acceptaient pas, EUX, de coopérer avec moi, quelle que soit la méthode que j’employerais, douce ou forte.
Le seul moyen de les faire taire réellement, indépendamment de leur volonté, ça aurait été de les baillonner et de leur mettre un scotch sur la bouche … Ce qui est un moyen que, évidemment, un moyen totalement illégal
Rappelez-vous de ça :
Quelle que soit la règle, il y a une part d’acceptation qui vient de l’enfant, sinon vous n’avez aucun moyen de la faire appliquer.
La règle idéale n’existe pas : passons au bricolage parental !
Alors, qu’est-ce qu’on fait avec ce constat, concrètement ?
Personnellement, je trouve que, en fait, c’est plutôt rassurant.
Déjà, ça nous incite à arrêter de chercher la règle parfaite, celle qu’on pourrait appliquer les yeux fermés, comme une recette.
Parce que cette règle idéale n’existe pas.
À la place de cette recherche, on peut faire quelque chose de beaucoup plus utile, de beaucoup plus réaliste : on va faire du bricolage.
Pas au sens bâclé, bancal. Non, au sens créatif du terme. On peut s’autoriser à tester, à ajuster, à observer.
Prenons une règle hyper simple : « on fait les devoirs tout de suite après le goûter ».
Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche tous les jours ? Est-ce que c’est tenable de manière raisonnable pour moi, pour mes enfants ?
Peut-être que oui, peut-être que non.
Donc, on va essayer, expérimenter, regarder : est-ce que mon enfant coopère ? À quel point est-ce qu’il coopère ? Est-ce que moi, j’arrive à tenir cette règle sans que ce soit vraiment trop compliqué ? Est-ce que cette règle me semble juste ? Est-ce qu’elle me semble utile ?
Et surtout, est-ce que finalement cette règle, au final, crée plus de liens que de tensions ? Est-ce qu’on arrive à trouver un équilibre tenable autour de cette règle ?
C’est ça qui va permettre de dire c’est une règle qui fonctionne pour nous, qui est tenable.
Et si ça ne marche pas, ça évite de se dire « je suis nul, je n’arrive pas à tenir« .
Ok, ce cadre-là, comme je l’ai posé, ne fonctionne pas : qu’est-ce qu’on peut ajuster sans renoncer complètement à ce qui compte pour nous ?
On va essayer une autre organisation, on va préciser la règle, on va peut-être expliquer mieux pourquoi c’est important, on voit comment l’enfant continue d’ajuster.
Moins de contrôle, plus de lien : vers une autorité relationnelle
Mais surtout, ça attire notre attention ce qui compte, c’est la qualité de la relation.
Meilleure sera la qualité de la relation que vous avez avec votre enfant, plus il sera enclin à coopérer avec vos règles.
Donc parfois, on va garder une règle, même si l’enfant conteste, parce que ça fait du sens et qu’on en a besoin.
Parfois, on va lâcher une règle parce qu’on s’aperçoit que finalement, il y a plus d’inconvénients à la tenir que d’avantages.
Ça n’est pas du laxisme, ni de l’autoritarisme évidemment. C’est ce qu’on pourrait appeler une autorité relationnelle.
On cherche l’équilibre entre les règles et la qualité de la relation.
La qualité de la relation permet à l’enfant de savoir qu’il peut compter sur vous quand il en a besoin, qu’il peut être écouté si la règle ne convient pas. Et ce sera plus simple de tenir les règles et de trouver les bonnes … C’est à dire celles qui fonctionnent POUR VOUS ET POUR LUI.
Se sentir compétent en tant que parent ça compte aussi !
C’est ça aussi qui va permettre qu’on se sente compétent dans son rôle de parent.
On n’a pas besoin d’être parfait. On n’a pas besoin d’être infaillible. On n’a pas besoin de trouver LA bonne manière de faire.
On est capable d’observer, de choisir, de tenir une ligne qui soit claire, mais aussi souple en même temps.
Donc vous l’aurez compris, je ne vous dirai pas quelle est la bonne règle à poser … ni quelle est la bonne manière de faire.
Je vous invite à poser la vôtre, à voir ce qui se passe, à observer et à l’ajuster s’il y a besoin, ou à l’assumer selon les cas … et à la faire vivre dans votre quotidien.
Et surtout donc, à vous faire confiance, non pas parce que vous avez coché les bonnes cases du bon parent, mais parce que vous êtes dans la construction d’une relation qui fonctionne, d’une relation qui vous convient et qui convient à votre enfant, et dans la construction partagée justement avec votre enfant.
J’espère que cet épisode vous a plu, n’hésitez pas à réagir évidemment en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Je serai ravie d’entendre votre avis sur ce que j’évoque dans cet article.
Et sur ce, je vous dis à très bientôt !
Pour finir …
Vous pensez avoir besoin d’un accompagnement ? Découvrez en plus sur mes accompagnements. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous directement en ligne :
Vous pouvez vous abonner à ma newsletter pour avoir les informations des nouveaux articles et aussi les infos sur les prochaines conférences :
Ce contenu vous a été utile ? Vous pouvez me le faire savoir en me faisant un don ponctuel ou récurrent. Ces dons me permettent de libérer du temps pour produire plus de contenu gratuit et accessible à tous.