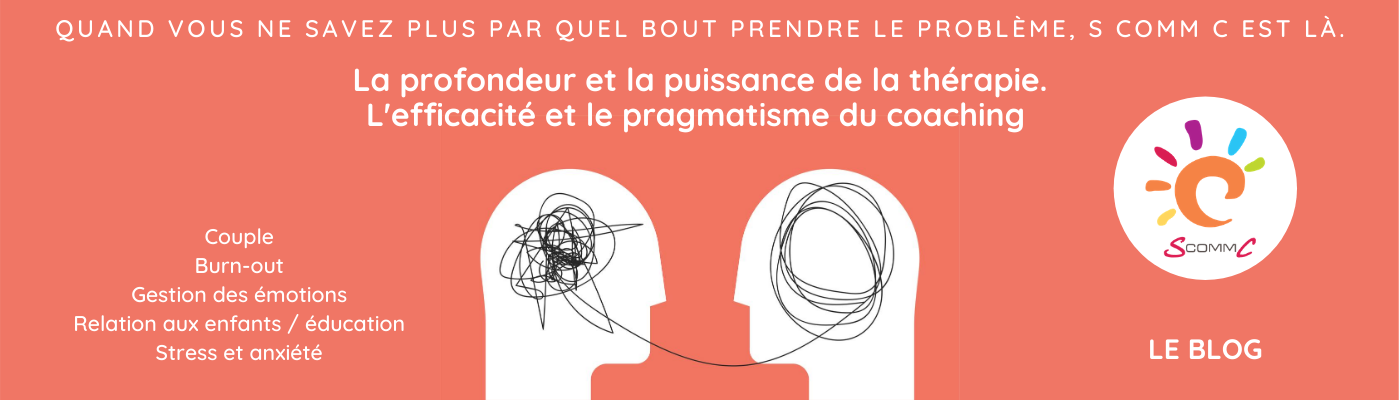Le juste milieu, encore une injonction à déconstruire en parentalité
Être un bon parent, ça suppose de trouver le juste milieu, de n’être ni trop rigide, ni trop laxiste. Franchement, cette idée me sort par les yeux. C’est encore une injonction à déconstruire en parentalité.
Alors zou, c’est parti : on va voir si vraiment être un bon parent, c’est trouver le « juste milieu ».

EP. 28 Le juste milieu, encore une illusion à déconstruire en parentalité – Du côté des parents !
Je n’avais pas du tout prévu de parler de ce sujet cette semaine, mais comme le disait John Lennon, la vie c’est ce qui arrive quand vous êtes occupé à faire d’autres projets et cette semaine la vie m’a envoyé un commentaire sur les réseaux sociaux.
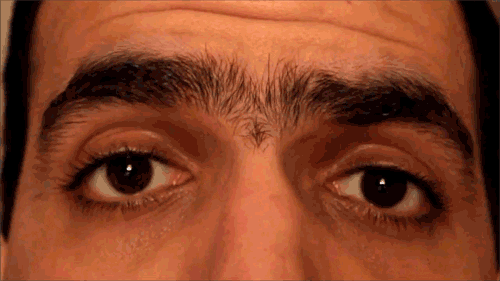
Ce commentaire m’a d’abord fait lever un premier sourcil d’agacement, puis un deuxième sourcil d’inquiétude. Et puis un troisième sourcil, finalement, de bonne surprise parce que ça m’a donné finalement envie d’en faire un épisode complet (oui j’ai 3 sourcils et alors !!!)
Le point de départ de ma réflexion est donc dans ce commentaire sous un post annonçant l’une de mes conférences intitulée « Autorité ou bienveillance et pourquoi pas les deux ?« .
Sous ce post, une personne commente :
« Ah oui, en fait il faut trouver le juste milieu, ne pas être ni trop rigide ni trop laxiste. »
Et là, en fait, mon sang n’a fait qu’un tour, parce que cette histoire de juste milieu me sort par les yeux.
D’abord parce que ma personnalité ne me porte pas tellement vers la tiédeur (mais ça c’est mon problème).
Et puis aussi parce que cette idée du juste milieu est franchement à côté de la plaque, notamment dans les problématiques familiales (mais pas que)
Le juste milieu comme moyen d’arbitrer le débat sur la bonne parentalité
Le juste milieu, ça sonne sage, réfléchi, pondéré et raisonnable (il n’y a pas de mal à être sage, pondéré, réfléchi et raisonnable hein !).
Mais dans le contexte actuel, les débats sur l’éducation sont quand même extrêmement polarisés – et pas que sur l’éducation, soit dit en passant. Vous avez les tenants de l’autorité et les tenants de la bienveillance qui se battent en duel par médias interposés, essayant chacun de convaincre les parents que leur façon de voir est la seule bonne, et que si vous optez pour autre chose vous êtes un mauvais parent.
Pour sortir un peu de cette bataille entre les différents types d’éducation, l’idée de l’équilibre du juste milieu a l’air d’être un peu la solution miracle.
On ne donne tort à personne (on ne donne raison à personne non plus, remarquez bien). Et ça a l’air d’être parfait : ni trop ferme, ni trop cool, un petit peu d’autorité, un petit peu de bienveillance, et on est bon.
Sauf que non, en fait, pas du tout !
Le problème avec le juste milieu
Le juste milieu c’est réduire la nuance à une simplification abusive.
La nuance est une façon d’appréhender la complexité des choses. Et là, le juste milieu c’est juste une façon de rejeter complètement le débat.
Bien sûr que rien n’est parfaitement bien ou terriblement mal, donc (ou pas grand chose). Et parce qu’il y a des avantages et des inconvénients, il faudrait être « au milieu ».
Comme ça on serait à peu près sûr d’avoir les avantages des deux options, mais pas les inconvénients.
Cette façon de voir me dérange profondément : j’aime la radicalité et les valeurs qu’elles portent, une vision, un engagement, une forme d’exigence.
Je n’ai donc pas tout envie de cette espèce de nuance aseptisée où, pour ne pas se tromper, il faudrait être au centre.
Je n’adhère pas à l’injonction à la neutralité qu’elle porte. C’est une fausse bienveillance qui refuse de prendre parti.
Les extrêmes, ça marche aussi en parentalité
La réalité, c’est que la radicalité peut très bien fonctionner.
Je rencontre des parents très cadrants, très exigeants, avec des attentes élevées. Un cadre que certains pourraient qualifier de maltraitant et autoritaire.
Et malgré cela, leurs enfants se sentent soutenus, entendus, respectés par leurs parents, et ça fonctionne.
Je rencontre aussi, à l’autre bout du spectre, des parents extrêmement souples, très à l’écoute. Attitudes que d’autres pourraient qualifier de laxistes, avec un cadre très très léger, très souple.
Je me reconnais d’ailleurs plutôt, moi, dans cette deuxième catégorie de parents, je l’avais peut-être déjà dit dans d’autres articles.
Mais ces parents – moi y compris – ont , avec des enfants qui, malgré ce cadre qui semble inexistant, sont autonomes, responsables, et ne rencontrent pas de problèmes ni dans la gestion de leurs émotions, ni dans leurs relations aux autres, ni dans leur adaptation à la société.
Dans ces formes de radicalité, il n’y a aucun problème ni philosophique ni en pratique.
Ici, je vais citer Donald Jackson, l’un des membres fondateurs de l’école de Palo Alto, le modèle de thérapie et d’accompagnement que je pratique.
Donald Jackson était psychanalyste mais a assez rapidement rejeté la psychanalyse, parce qu’il trouvait que ça ne permettait pas de comprendre la dynamique familiale. Après avoir travaillé au M.R.I. de Palo Alto, il a été à l’origine de ce qu’on appelle aujourd’hui la thérapie familiale avec Virginia Satir. Il a fondé « Family Process », le 1er journal indépendant consacré aux problématiques familiales.
Voilà ce que disait Donald Jackson :
Après avoir étudié la famille pendant de nombreuses années, j’estime pouvoir avancer qu’il n’existe pas de familles normales, pas plus qu’il n’existe d’individus normaux.
Il est des parents qui semblent vivre dans la plus grande harmonie mais dont les enfants sont nerveux, des parents qui s’entendent fort mal mais dont les enfants semblent en bonne santé.
Lorsqu’on entend quelqu’un s’écrier : « Ah voilà une famille normale ! », qu’on sache que celui qui s’exprime ainsi ne considère, en général, qu’une certaine facette de la vie familiale et non pas son interaction d’ensemble, laquelle reste impénétrable à l’observation naïve. Les personnes qui s’expriment ainsi sont en général de celles qui accordent une grande valeur au conformisme.
Lorsqu’on entend quelqu’un s’écrier « Ah, voilà une famille normale !», qu’on sache que celui qui s’exprime ainsi ne considère en général qu’une certaine facette de la vie familiale, et non pas son interaction d’ensemble, laquelle reste impénétrable à l’observation naïve.
Les personnes qui s’expriment ainsi sont en général celles qui accordent une grande valeur au conformisme. »
Donald Jackson dénonce l’idée que se conformer à la norme édictée par la société reviendrait à obtenir un « bon » résultat. La radicalité, à l’inverse, c’est s’écarter de cette définition dictée par la société.
PS : j’avais commenté cette citation en détail dans cet article.
La radicalité fonctionne, jusqu’au jour où elle ne fonctionne plus
Et la radicalité peut très bien fonctionner jusqu’au jour où ça ne fonctionne plus.
Je m’explique : un cadre strict peut très bien fonctionner toute la vie de la famille et ne poser aucun problème.
Mais il arrive aussi qu’on a des parents très organisés, très cadrants sur les devoirs, les repas, les couchers, les écrans, etc. Et puis, un jour, ça fonctionne moins bien.
L’enfant, il peut se mettre à mentir, à contourner les règles ou alors il commence à aller mal, à être déprimé ou anxieux.
Et qu’est-ce qui se passe à ce moment-là ? C’est possible que le parent se mette à mettre plus de contrôle, plus de surveillance, notamment si l’enfant contourne les règles. Le parent se dit : « là, il faut que je resserre le cadre parce que mon enfant, visiblement, n’a pas compris ».
Et peut-être que ça, ça va fonctionner.
C’est-à-dire, effectivement, on remet du cadre et puis hop, ça va mieux, la relation s’apaise et l’enfant retrouve un comportement adapté.
Mais peut-être aussi qu’on va commencer une espèce de cercle vicieux où finalement, quand le parent resserre la vis, ce qu’il obtient, c’est un enfant qui résiste, contourne, ment, se plaint encore plus.
Ça n’est pas que le cadre est mauvais.
Ça n’est même pas que resserrer le cadre quand l’enfant fait quelque chose de travers est mauvais.
C’est qu’on persiste à faire quelque chose qui ne fonctionne pas.
Parce que sans doute qu’à ce moment-là, il va falloir, au contraire, assouplir le cadre, être à l’écoute, rediscuter ce cadre pour que l’enfant se sente à nouveau bien et que la relation redevienne bonne et que ça puisse fonctionner entre les deux.
À l’inverse, je vois régulièrement des parents très à l’écoute, très disponibles, et à un moment donné, l’enfant va moins bien.
Il est envahi par ses émotions, il a du mal à respecter les limites, il a du mal à respecter les autres, il a du mal dans ses relations aux autres, il devient de plus en plus sensible, il a de plus en plus de tempêtes émotionnelles ou il est de plus en plus déprimé ou de plus en plus anxieux.
Et le parent, fort légitimement, se dit : « Mais peut-être que si mon enfant ne se sent pas bien, c’est qu’il a besoin d’encore plus d’écoute, encore plus de disponibilité. Je dois comprendre le besoin qu’il y a derrière ces émotions ».
Et le parent se met encore plus dans cette position d’écoute, de tolérance pour les débordements, en se disant il y a un besoin qui n’est pas entendu.
Et peut-être que, en effet, c’est ce dont l’enfant avait besoin et que ce surplus de disponibilité et d’écoute va fonctionner, va aider l’enfant à aller mieux.
Mais peut-être aussi que ce n’est pas ce dont l’enfant a besoin et qu’au contraire, à ce moment-là, l’enfant a besoin d’un cadre plus strict, de règles et de moins de disponibilité.
Le problème n’est pas de savoir si c’est bien ou mal … c’est de persister quand ça ne marche pas
Donc là encore, on le voit : le problème, ce n’est pas la stratégie de départ. Ce n’est même pas le fait d’essayer de renforcer sa stratégie de départ.
C’est le fait de persister dans une stratégie qui ne donne pas les résultats attendus.
Donc l’idée, ce n’est absolument pas le juste milieu. On n’en a rien à fiche du juste milieu !
L’idée, c’est savoir faire demi-tour.
La bonne parentalité, ce n’est pas trouver quelle est la bonne manière de s’y prendre. C’est la faculté à s’ajuster à ce qui se passe entre mon enfant et moi.
Etre un bon parent, c’est arrêter d’essayer de passer à travers le mur du fond de l’impasse dans lequel vous êtes coincé, en y mettant des coups de tête.
Si vous avez déjà mis quelques coups de tête et que le mur ne s’est pas écroulé, il va falloir arrêter de mettre des coups de tête et faire demi-tour.
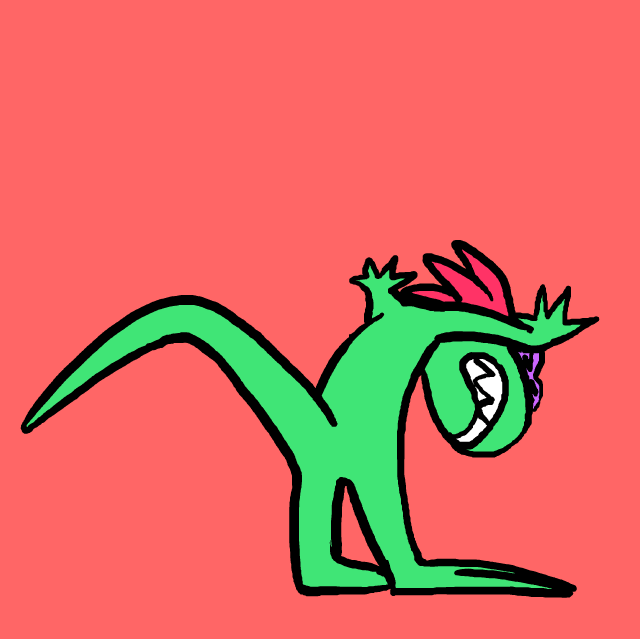
Comment savoir si on est dans la bonne voie ?
Comment est-ce qu’on sait qu’on est en train de mettre des coups de tête dans un mur ?
La réponse est simple : ça fait mal.
Et dans la relation avec nos enfants, ça fait mal aussi.
Si ce que vous faites vous demande de plus en plus d’efforts, que la relation se dégrade, que votre enfant, le comportement de votre enfant ne s’améliore pas, ou que votre enfant ne va pas mieux, c’est que quelque chose ne va pas.
Et c’est ça qu’il faut regarder.
Ce n’est pas : « est-ce que je fais bien ou mal ? Est-ce que je suis dans le juste milieu ? »
C’est : « est-ce qu’il y a de la souffrance quelque part, notamment dans la relation ou dans moi, ce que je ressens ? »
Parce que s’il y a souffrance, ça veut dire qu’il faut changer quelque chose.
Donc le juste milieu vous pouvez le mettre à la poubelle et vous consacrer à repérer s’il y a ou non une souffrance, un sentiment d’impuissance quelque part.
Alors évidemment, savoir comment changer – qu’est-ce qu’il faut faire de différent ? – parfois on le trouve assez spontanément, parfois c’est plus compliqué.
Et c’est là où on peut avoir besoin d’un accompagnement, pas avec quelqu’un qui vous propose une méthode mais quelqu’un qui va vous aider à voir ce que vous pouvez faire de différent pour sortir de la souffrance.
La parentalité, ça ne doit pas faire mal. Si ça fait mal, c’est qu’il y a quelque chose à changer.
Pour finir …
Vous pensez avoir besoin d’un accompagnement ? Découvrez en plus sur mes accompagnements. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous directement en ligne :
Vous pouvez vous abonner à ma newsletter pour avoir les informations des nouveaux articles et aussi les infos sur les prochaines conférences :
Ce contenu vous a été utile ? Vous pouvez me le faire savoir en me faisant un don ponctuel ou récurrent. Ces dons me permettent de libérer du temps pour produire plus de contenu gratuit et accessible à tous.